La Jornada – Le 30 juin 2013 – Guillermo Almeyra
(Traduction Jean-Paul Damaggio)
Les soi-disant gouvernements « progressistes » appliquent des politiques néolibérales, légèrement modifiés par des mesures de protection sociale pour soutenir la consommation intérieure, et une forte intervention de l’Etat pour affirmer la domination capitaliste en général, avec en particulier un consensus apprécié – qui vient en grande partie de la peur d’un plus grand mal déjà connu.
Le gouvernement de Lula et celui de Dilma Rousseff n’ont pas fait de réforme agraire, mais au contraire ils ont renforcé l’agrobusiness, et transformé les terres où on cultivait les éléments de base de l’alimentation populaire par la production de canne à sucre qui est cultivée pour produire de l’éthanol, préférant les automobiles aux Brésiliens, ils ont permis que le grand capital gagne comme jamais auparavant, et ils ont réprimé sans dégoût dans les favelas, dans les champs, dans les régions autochtones. Poussé par les difficultés économiques (l’économie a progressé de seulement 0,9 %, alors que le taux de fécondité atteint 2,14 %, ce qui montre que, par tête d’habitants, les Brésiliens s’appauvrissent), ces gouvernements ont favorisé de plus en plus les transnationales et domestiqué de plus en plus les syndicats qui font partie de l’appareil d’État capitaliste.
Alors qu’ils conduisent, ce que Gramsci appelle une révolution passive (c’est-à-dire par les solutions ci-dessus, limitées et mêlées à des mesures réactionnaires et antinationales, travailler pour unifier et moderniser le pays), les autorités croient qu’il suffit d’acheter des dirigeants d’organisations sociales, d’empêcher l’indépendance politique de travailleurs, de chercher des parlementaires alliés dans les partis bourgeois en leur donnant des privilèges, et se taire pour les pauvres, avec cadeaux et événements sportifs.
Ils facilitent l’achat de voitures, de sorte que les villes sont de plus en plus polluées et le trafic devient de plus en plus chaotique (à Sao Paulo la vitesse moyenne est passée de 20 kilomètres / heure il y a quelques années à 12 actuellement et un travailleur doit consacrer trois heures par jour au « plaisir », de se serrer dans des transports de plus en plus pire et plus cher).
Alors que les inégalités sociales se développent, ces gouvernements confondent le soutien électoral et un chèque en blanc pour faire quoi que ce soit. C’est pour ça, par exemple, qu’en Bolivie éclata le gasolinazo (augmentation de 80 % du prix du carburant, sans préavis) qu’Evo Morales annula le lendemain et le Brésil urbain se lève quand augmente l’extorsion d’argent par la hausse du prix du billet pour le transport public (déjà cher, puisqu’un habitant de Sao Paulo doit consacrer à lui verser l’équivalent de 14 minutes de salaire minimum contre seulement 1 minute et 31 secondes pour un travailleur de Buenos-Aires) et s’ajouta l’affront intolérable de la sauvage répression de la police militaire.
Même si Dilma et le gouvernement ont annulé cette augmentation, ils ne répondirent pas ainsi à la cause première de la protestation, qui a éclaté à l’occasion de la mesure, mais avec des racines beaucoup plus profondes tenant à la rage accumulée par la détérioration de la qualité de vie, l’augmentation de l’exploitation, la richesse honteuse de l’oligarchie, la corruption de l’État, la violence de l’appareil d’État. Les gouvernements qui acceptent le capitalisme comme un cadre unique, qui veille à « l’humaniser » et qui théorisent, comme Cristina Fernández avec Laclau, qu’il n’existe plus de lutte de classes ni de classes, se retrouvent tout d’un coup face à des travailleurs et des classes moyennes pauvres qui ne se contentent plus de Bourses de famille, de la télévision et du football quand ils se voient obligés de faire comme les plus pauvres ne mangeant que deux fois et il faudrait qu’ils appelle ça un énorme progrès.
C’est la base du lullisme-dilmismo qui se divise aujourd’hui entre ceux qui n’ont aucune terre ou de solutions dans le monde rural et qui étant très limités dans leurs attentes économiques ne peuvent protester, et les autres, plus instruits, des secteurs urbains qui ne veulent pas vivre seulement d’assistance sociale et de football et qui demandent la démocratie, une éducation décente ou la qualité de vie.
60% des habitants de la région de São Paulo vivent en ville. Au Brésil, selon le recensement de 2010, 84,4 % des habitants sont déjà urbanisés. En outre, bien que l’espérance de vie augmente, la grande majorité de la population brésilienne, a moins de 40 ans. C’est la jeunesse urbaine qui a lancé la révolte et elle ne s’arrêtera pas. On a comparé le cas du Brésil avec la révolution arabe, mais au Brésil Lula et Dilma ont un soutien populaire très fort. En outre, les protestations ne furent pas seulement contre le maire de São Paulo, qui est du PT, mais également elles ont eu lieu contre les maires de droite ou des partis alliés et concurrents du PT. Les partis ont été empêchés de brandir leurs drapeaux parce que, comme il est également arrivé à Buenos Aires avec les assemblées populaires de 2002, les gens ordinaires voulaient peser directement dans la vie politique et pas être manipulés ou instrumentalisés par les partis ou des sectes souhaitant pêcher en eau trouble.
L’axe du problème est le niveau actuel de la subjectivité des manifestants. Les revendications n’allèrent pas au-delà du rejet de l’augmentation de la protestation contre la violence de la police militaire et la corruption. Le Brésil n’a jamais rencontré de mouvements de masse indépendants au cours de son histoire. Son indépendance, fut proclamée par le fils du roi du Portugal devenant empereur, et même les grandes grèves des années 70 qui renversèrent la dictature ne furent pas complètement indépendantes, puisqu’elles faisaient partie de l’opposition avec des partis bourgeois. Ce qui est important, par conséquent, ce n’est pas la limitation des revendications, mais le fait que le mouvement a été spontané, exprimant l’aspiration à la démocratisation de la vie politique et sociale et débordant les partis et les appareils. Nous ne sommes pas face à une révolution, mais face à une rébellion démocratique de la majorité des jeunes en milieu urbain, qui refuse de rester simple objet des politiques burocratico-technocratiques des agents des grandes entreprises déguisés en «progressistes ».
Mais elle crée les conditions d’un large front politique qui bouleverse toutes les données politiques au Brésil. En ce moment où le chavisme se débat entre la crise ou son approfondissement, et que Kirchnerisme s’épuise, ce qui se passe au Brésil a une importance énorme. La crise du capitalisme, de réduisant les fondements des droits démocratiques et en menaçant les niveaux de vie conquis au cours des dix dernières années, permet d’accélérer sa transformation. Mais il manque encore le programme, des idées, et même le désir de comprendre ce nouveau processus à gauche, à l’extérieur et au sein du PT. Pour développer le potentiel du processus nous avons avant tout besoin de clarté théorique et politique.
Publié le 1er juillet sur « AlterAutogestion », le blog de notre camarade Richard NEUVILLE (Alternatifs 07)
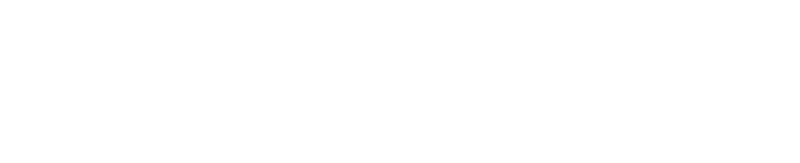
Soyez le premier à poster un commentaire.