Publié le
samedi, 16 mai 2015 dans
InternationalLa volonté de l’Eurogroupe de se débarrasser du ministre grec des Finances ne repose pas sur un « style », mais bien plutôt sur des divergences plus profondes.
 Il semble que l’exercice soit devenu le passage obligé de tout journaliste travaillant sur les questions européennes. Depuis quelques semaines, les colonnes des journaux s’emplissent d’articles à charge contre le ministre hellénique des Finances, Yanis Varoufakis. Le dernier en date est celui publié par le journal français de référence, Le Monde, qui titre, avec appel de une, sur « l’exaspérant Monsieur Varoufakis. »
Il semble que l’exercice soit devenu le passage obligé de tout journaliste travaillant sur les questions européennes. Depuis quelques semaines, les colonnes des journaux s’emplissent d’articles à charge contre le ministre hellénique des Finances, Yanis Varoufakis. Le dernier en date est celui publié par le journal français de référence, Le Monde, qui titre, avec appel de une, sur « l’exaspérant Monsieur Varoufakis. »
L’agacement européen
Le schéma de ces articles est souvent le même : l’homme est jugé évidemment compétent (il est difficile de lui contester cette qualité, sauf à contester celle des habituels « clients » des journaux économiques), mais insupportable et absolument nul en négociations.
De nombreuses citations issues de Bruxelles suivent pour montrer combien, en effet, cet économiste grec est « agaçant » aux yeux des fonctionnaires et officiels européens, avec ses chemises bariolées, son ton docte et son « fort ego ».
Son crime principal, aux yeux de Bruxelles, est de ne pas avoir changé pour « rentrer dans le rang ». Comme le « déplore une source européenne », pour reprendre l’article du Monde daté du mardi 12 mai, il a refusé de suivre le chemin de son prédécesseur Evangelos Venizelos, le président du Pasok, qui, lui avait « changé ».
Pour finir, le portrait du ministre est celui d’une « rock star », d’un Icare médiatique attiré irrésistiblement par le soleil médiatique. Entre les lignes, le lecteur comprend que, si ce Yanis Varoufakis est si insupportable, c’est parce qu’il n’est qu’un narcisse superficiel qui fait son « show ». Son rôle n’aura été que d’agiter les bras pour rendre les négociations aussi captivantes qu’une série américaine. Bref, ce ministre n’est qu’une sorte de clown, utile un moment, mais qui aurait fait son temps.
Le storytelling européen contre Yanis Varoufakis
Cette image a été construite soigneusement par l’Eurogroupe et la Commission depuis les premiers jours du gouvernement Tsipras. Le président de l’Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem n’a jamais caché qu’il n’avait pas digéré « l’humiliation » du 30 janvier, lorsqu’un Yanis Varoufakis, très à l’aise, l’avait surpris en proclamant la fin de la troïka.
L’acmé de ce storytelling a été la réunion de Riga du 25 avril, lorsque le ministre grec a été accusé par ses dix-huit collègues d’être à l’origine du blocage. Ce même storytelling, tissé avec soin par Jeroen Dijsselbloem le soir du 11 mai, a enfoncé le clou en notant les « progrès » des négociations une fois la « rock star » disparue.
Mais tout ceci n’est qu’un écran de fumée. Alexis Tsipras a été soucieux d’ôter rapidement un argument aux créanciers. Depuis, les négociations n’ont en réalité pas véritablement avancé. La situation reste la même : les négociations n’avancent que parce que la Grèce fait des concessions. Yanis Varoufakis ou pas, les blocages demeurent : la Grèce refuse toujours les « réformes » des retraites et du marché du travail que lui réclament ses créanciers.
Yanis Varoufakis n’était, en réalité, pas le problème. Son rejet était le symptôme d’un rejet politique du nouveau gouvernement grec.
Le miroir amer tendu par le ministre à ses collègues
La réalité du « problème Varoufakis » est donc ailleurs. Elle peut se décliner en plusieurs points.
Le premier est la détermination du ministre-économiste à placer ses collègues devant leurs responsabilités. En 2010, Yanis Varoufakis s’était opposé aux « plans de sauvetage », jugeant, non sans raison, comme il le soulignait dans son ouvrage Le Minotaure Planétaire*, que « les remèdes que l’Europe applique sont pires que le mal ». Pour lui, il était donc urgent – et c’était la tâche à lui assignée par Alexis Tsipras – de rompre avec la logique du « programme » qui a conduit la Grèce dans une spirale déflationniste et a détruit une grande part de sa capacité productive. D’où les coups de boutoir assénés à ce système lors des premiers jours du gouvernement : le refus de discuter avec la troïka, les demandes de restructuration de la dette, le blocage de l’Eurogroupe sur la question du « programme existant ».
Pour les collègues de Yanis Varoufakis, cette remise en cause de la logique en place depuis 2010 est inacceptable. D’abord parce que cette logique est le ciment de l’Eurogroupe, lequel n’a jamais fait de mea culpa sur cette politique. Mais surtout parce que cette politique remettait en cause un autre storytelling européen : celui de la reprise de l’économie grecque grâce aux « réformes qui portent enfin leurs fruits ». Or, Yanis Varoufakis, en bon économiste, sait parfaitement que cette « reprise » est à la fois de façade et fragile. Après un effondrement économique inédit en temps de paix, seul un effort d’investissement massif au niveau européen allié à une restructuration de grande ampleur de la dette peut réellement contribuer à redresser le pays. Mais cette vision s’oppose à la pensée dominante de l’Eurogroupe: la purge est nécessaire et doit être menée jusqu’au bout pour qu’advienne « la croissance saine ».
Yanis Varoufakis est donc, dans l’Eurogroupe, un corps idéologique étranger qui leur tendrait le miroir hideux des erreurs de l’Europe depuis 2010. En réclamant un changement de politique envers la Grèce, le ministre hellénique prend des allures de mauvaise conscience insupportable venant briser le mythe de la reprise radieuse qui succède à l’austérité.
Et pire, il s’entête. Et c’est là tout le sens de la déploration de la « source européenne » citée par « Le Monde » : en 2011 aussi, Evangelos Venizelos avait tenté de mettre en garde contre ces erreurs. Mais, heureusement, il était rentré dans le rang. Et l’on avait pu continuer cette politique insensée qui a ruiné la Grèce.
Quatre ans plus tard, Yanis Varoufakis ne peut accepter de faire la même erreur. Et c’est pourquoi il fallait l’écarter.
L’obsession de la justice sociale
Pourquoi cet entêtement ? Principalement, parce que le ministre a une obsession – et c’est sa deuxième faute devant les créanciers-, celui de la justice sociale. Sa position est que l’austérité pratiquée depuis cinq ans en Grèce a surtout fait payer les plus pauvres.
Des études sont, du reste, venues lui donner raison. Il sait que la nature de la reprise ne pouvait guère renverser la vapeur et, là aussi, il demande donc une action urgente. D’où son insistance, dans les deux premiers mois du gouvernement, à intégrer aux discussions avec l’Eurogroupe le traitement de « l’urgence humanitaire ». Son ambition affichée est politique : le développement de la pauvreté et la paupérisation des classes moyennes font évidemment le jeu des extrêmes.
La position du ministre grec est alors simple : l’Europe doit utiliser la victoire de Syriza comme une chance en écoutant ses propositions « modérées » afin d’éviter d’avoir à traiter avec les extrêmes, du type Aube Dorée. Le 5 février, devant Wolfgang Schäuble, il met ainsi en garde :
« Quand je reviendrai chez moi ce soir, je me trouverai devant un parlement dans lequel le troisième parti n’est pas un parti néo-nazi, mais un parti nazi. »
Mais ce discours est inaudible au sein d’un Eurogroupe qui juge précisément que les Grecs sont déjà aux mains d’extrémistes qu’il faut mater (en avril, un officiel déclarera qu’Alexis Tsipras doit rompre avec son aile gauche). Les ministres de la zone euro n’y voient qu’un chantage à Aube Dorée pour leur arracher des concessions.
Surtout, le traitement « social » de la pauvreté est, pour les Européens, une erreur. Là encore, l’idéologie joue à plein. Dans la vision de l’Eurogroupe, la lutte contre la pauvreté vient naturellement après, c’est une conséquence de l’assainissement et de la libéralisation de l’économie. Ces deux éléments créent de la richesse qui, in fine, se répand dans les couches les plus basses de l’économie. La patience est donc une obligation. Mieux même, tout traitement « social » de ce problème freine la mutation « structurelle » nécessaire en accroissant le rôle de l’Etat et en créant des distorsions sur le marché de l’emploi.
Bref, les demandes de Yanis Varoufakis ne sont que du misérabilisme au mieux, du populisme au pire. On aura la preuve évidente de cette idéologie à la mi-mars lorsqu’un fonctionnaire européen tente de stopper la loi de lutte contre l’urgence humanitaire.
Sur ce plan, Yanis Varoufakis a finalement eu raison des créanciers, la loi est passée. Mais cette victoire n’est que partielle: la lutte contre la pauvreté doit passer par un changement de politique, donc par la remise en cause de la logique du programme.
Un problème personnel qui cache un fossé idéologique
Le troisième point de rupture avec Yanis Varoufakis: il a en réalité payé sa cohérence. Le ministre hellénique n’a jamais abandonné ses objectifs. Jusqu’à ce lundi 11 mai au soir où il a répété que les deux « lignes rouges » d’Athènes étaient la fin du cercle vicieux déflationniste et la meilleure répartition de l’effort. Bref, les deux précédents points de rupture.
A chacune de ses listes de réformes, toutes rejetés par l’Eurogroupe, il a pris en compte ces deux éléments: meilleure justice dans la répartition de l’impôt, lutte contre l’évasion fiscale des entreprises et des plus aisés, facilitation de la reprise par la mise en place d’un traitement des arriérés fiscaux pour les PME et les particuliers…
Le cœur du rejet de ces listes, comme celui de l’agacement que susciterait Yanis Varoufakis, ne réside pas en réalité dans les chemises fantaisie du ministre ou dans son aspect décontracté de rock star. Il repose sur des fondements idéologiques. Les créanciers européens ne veulent pas admettre leurs erreurs passées, car c’est tout le fondement de leur logique économique qui s’effondrerait alors. Ils ne peuvent donc admettre les positions de Yanis Varoufakis. La volonté de le discréditer en permanence n’est donc pas le fruit d’une logique personnelle.
Les leçons du François Hollande de 2012
Beaucoup cependant s’interrogent sur le style trop « agressif » du ministre grec. La critique est fréquente du manque de « sens politique » de Yanis Varoufakis, qui n’a pas accepté les règles en vigueur à Bruxelles pour les contourner.
Ceci s’explique cependant aisément par le précédent français. Comme il l’avait souligné, dix jours avant l’élection, dans un entretien accordé à « La Tribune », Yanis Varoufakis a été marqué par les suites de l’élection de François Hollande qui, selon lui, n’a « rien tenté » contre la logique austéritaire. Du coup, la stratégie du compromis du président français en 2012, qui s’est soldée par un échec patent (le fameux « pacte de croissance » dont l’existence reste à prouver) est devenu la stratégie à éviter par excellence.
Face à un blocage idéologique, le ministre grec a tenté de forcer la décision en prenant d’emblée des mesures fortes, comme la dissolution unilatérale de la troïka. Le succès de cette stratégie n’est pas certain, mais elle a clairement mis les Européens dans l’embarras, les confrontant aux conséquences ultimes de leur propre fermeté.
La réalité de la stratégie européenne
En réalité, derrière ce durcissement, la position de Yanis Varoufakis était une des plus modérée au sein de Syriza. Le ministre grec a toujours été défavorable à la sortie de la zone euro, il a toujours proposé une solution européenne au problème grec.
Alexis Tsipras aurait pu nommer Costas Lapavitsas, par exemple, un économiste de Syriza clairement partisan de l’annulation de la dette et de la sortie de l’euro. Les créanciers auraient alors pu paniquer.
En détruisant Yanis Varoufakis, les Européens ont dévoilé leur but: non pas trouver un « compromis » raisonnable, mais mettre au pas un gouvernement qui ne leur convient pas. Comme le souligne dans la préface à l’édition française du Minotaure Planétaire, Yanis Varoufakis, « l’Union européenne a, de longue date, pris l’habitude de considérer la démocratie comme un luxe et un désagrément ».
 Il semble que l’exercice soit devenu le passage obligé de tout journaliste travaillant sur les questions européennes. Depuis quelques semaines, les colonnes des journaux s’emplissent d’articles à charge contre le ministre hellénique des Finances, Yanis Varoufakis. Le dernier en date est celui publié par le journal français de référence, Le Monde, qui titre, avec appel de une, sur « l’exaspérant Monsieur Varoufakis. »
Il semble que l’exercice soit devenu le passage obligé de tout journaliste travaillant sur les questions européennes. Depuis quelques semaines, les colonnes des journaux s’emplissent d’articles à charge contre le ministre hellénique des Finances, Yanis Varoufakis. Le dernier en date est celui publié par le journal français de référence, Le Monde, qui titre, avec appel de une, sur « l’exaspérant Monsieur Varoufakis. »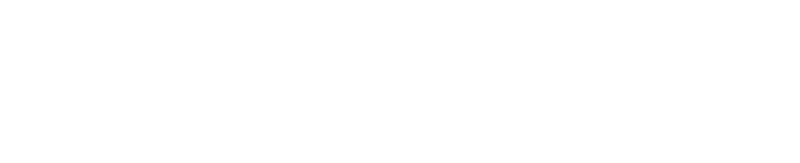
Soyez le premier à poster un commentaire.