Tribune libre : Des arguments en défense de l’accord conclu par Syriza. Par Ludovic Lamant – Mediapart.fr
 Des intellectuels montent au créneau pour défendre l’accord décroché par Syriza à Bruxelles, qui a le mérite d’« acheter du temps ». Mais ce fragile compromis renforce aussi la voix d’adversaires de l’euro, qui plaident pour une rupture plus musclée avec les institutions.
Des intellectuels montent au créneau pour défendre l’accord décroché par Syriza à Bruxelles, qui a le mérite d’« acheter du temps ». Mais ce fragile compromis renforce aussi la voix d’adversaires de l’euro, qui plaident pour une rupture plus musclée avec les institutions.
Dans un entretien publié sur Mediapart trois semaines avant le triomphe électoral de Syriza en Grèce, l’universitaire Gerassimos Moschonas pronostiquait : « Syriza va tester la flexibilité, ou l’inflexibilité, de l’Europe. » Les premiers compromis intervenus à Bruxelles, un mois après l’élection d’Alexis Tsipras, ne permettent pas encore de trancher l’alternative. Mais ils confirment à quel point le pari de Syriza d’infléchir la machine bruxelloise sera difficile, surtout si la coalition de gauche reste à ce point isolée.
Les ministres des finances de la zone euro ont prolongé de quatre mois le programme d’aide qui avait été négocié par le précédent gouvernement d’Antonis Samaras, en novembre 2012, pour éviter la banqueroute du pays. Mardi, Athènes a transmis à ses créanciers (BCE, FMI, commission européenne) la liste de réformes qu’il souhaite mettre en place d’ici juin, dans le cadre de ce programme, en s’engageant à ce qu’elles n’aient pas d’effet négatif sur les comptes publics (lire l’article d’Amélie Poinssot).
Le compromis, qui éloigne pour un temps le spectre du Grexit (la sortie de la Grèce de la zone euro), peut paraître dur à avaler, pour le parti de la gauche étiquetée « radicale ». Certaines figures de Syriza n’ont pas tardé à dénoncer ce qu’elles considèrent comme des renoncements. Mais plusieurs intellectuels de premier plan, ancrés à gauche, sont aussi montés au créneau en défense de l’accord. Non, Syriza n’a pas capitulé, estiment-ils. L’exécutif grec a « acheté du temps », selon la formule consacrée, c’est-à-dire quatre mois, jusqu’à fin juin, pour négocier un accord plus ambitieux. Bref, la « révolte des débiteurs », pour reprendre l’expression de l’économiste belge Paul de Grauwe, n’a pas encore abouti, mais cela ne saurait tarder.
Alexis Tsipras lors de son premier sommet bruxellois, le 12 février dernier.
« Cela aurait pu être pire », juge Paul Krugman, le « Nobel » d’économie dans l’un de ses derniers billets pour le New York Times. « La Grèce a obtenu des conditions un peu plus douces pour cette année, et de l’oxygène pour mener la grande bataille à venir », résume-t-il. Aux yeux de Krugman, le nerf de la guerre porte sur les objectifs budgétaires pour 2015 et l’an prochain. Et sur ce seul critère, Athènes s’en sort bien, écrit-il.
D’après l’accord négocié en 2012, le gouvernement grec s’engage à réaliser un « surplus budgétaire primaire » (son excédent budgétaire, hors paiement des intérêts de la dette) de 3 % du PIB en 2015, et de 4,5 % en 2016. Dans le compromis de vendredi, les Grecs « n’ont pas été forcés à s’engager sur des surplus budgétaires très élevés », selon l’Américain. Le communiqué de vendredi précise, pour la seule année 2015, que les ministres prendront en compte les « circonstances économiques », ce qui ouvre la voie à une certaine flexibilité. Et Krugman d’enfoncer le clou : « Cela ressemble à une défaite pour la Grèce. Mais puisque rien de substantiel n’a été résolu, ce ne sera qu’une défaite si les Grecs l’acceptent comme telle. (…) On peut donc en conclure que c’est un bon résultat : il est maintenant l’heure pour la Grèce de passer aux actes. »
Sans surprise, l’un des défenseurs les plus enthousiastes de l’accord n’est autre que l’Américain James K. Galbraith, co-auteur d’un essai avec Yanis Varoufakis, l’actuel ministre des finances grec, au début de la crise (Modeste proposition pour résoudre la crise de la zone euro – lire notre compte-rendu). Dans son analyse, il propose de lire le compromis de vendredi « correctement », c’est-à-dire à l’encontre d’une majorité de journalistes en poste à Bruxelles, et d’observateurs qui ont parlé de défaite pour Syriza.
Pour Galbraith, la Troïka des créanciers est bien de l’histoire ancienne. Il reprend l’argument de Varoufakis vendredi, selon lequel les Grecs sont devenus « les auteurs, ou plutôt les co-auteurs » des réformes à venir, là où la Troïka leur imposait des mesures sans marge de manœuvre. « Si vous pensez pouvoir trouver dans le corps du texte, un seul engagement inébranlable qui oblige à souscrire aux termes et conditions exacts du « programme actuel » (le mémorandum de la Troïka), eh bien, bonne chance, juge l’universitaire. Cela n’y figure pas. Donc, non, la Troïka n’est plus autorisée à venir à Athènes, et protester contre la ré-embauche des femmes de ménage (du ministère de l’économie, qui avaient été licenciées sous le gouvernement précédent, ndlr). »
Galbraith fait allusion au processus qui s’est engagé en début de semaine : Athènes a fait parvenir sa liste de réformes que l’Eurogroupe a validées. À charge pour le gouvernement de les mettre en œuvre, tout en respectant les engagements liés à l’accord de 2012. En cours de route (d’ici fin avril, dit le communiqué), les « institutions » de l’ex-Troïka se déplaceront en Grèce pour vérifier l’avancée des travaux, et débloquer les fameux sept milliards d’euros – la dernière ligne de prêt du plan d’aide de 2012. Une manière de maintenir la pression sur Athènes tout au long des semaines à venir.
À ceux qui s’inquiètent de l’interdiction, pour le gouvernement grec, de prendre des « mesures unilatérales » (c’est-à-dire sans consulter, au préalable, BCE, FMI et commission), Galbraith répond : « C’est un engagement qui ne durera que durant quatre mois, le temps de trouver un véritable accord. » À ceux qui regrettent l’absence de vraies marges de manœuvre budgétaires, pour faire redémarrer l’économie à partir d’une relance keynésienne, il rétorque : « Mais dans quel document (de Syriza, ndlr) cette promesse figure-t-elle ? Il n’y a pas d’argent en Grèce. Le gouvernement est en faillite. Il n’a jamais été question de politiques keynésiennes à grande échelle, parce qu’elles entraîneraient forcément une sortie (de la zone euro, ndlr), avec tous les dangers que cela représenterait. »
Pour Galbraith, l’accord de vendredi ménage l’essentiel : il offre quelques marges budgétaires, pour lancer des pans du programme « humanitaire » promis par Tsipras, et donne quatre mois à la Grèce pour négocier un accord digne de ce nom. Ce succès de Syriza s’explique pour une raison simple : « En bout de course, la chancelière Merkel a préféré ne pas être la dirigeante en Europe responsable de la fragmentation de l’Europe. »
L’analyse a été reprise mercredi point par point par Vicenç Navarro, économiste espagnol keynésien, ex-conseiller économique de Bill Clinton, et devenu l’un des « experts » qui ont écrit le programme économique de Podemos l’an dernier. « La chose à retenir des négociations, c’est que, malgré l’énorme déséquilibre de forces, la mobilisation d’un peuple en soutien à des exigences justes de son gouvernement peut déboucher sur des victoires, au fil d’un processus dont nous n’avons vu, pour l’instant, que le début d’une bataille plus large, et c’est maintenant que la partie difficile s’engage. » Et de prévenir : « La grande panique qui traverse la structure du pouvoir européen, c’est que la prochaine étape de cette bataille se déroule en Espagne. C’est pour cela que les victoires de Syriza sont aussi les victoires des peuples d’Europe. »
Quatre mois pour… « préparer la sortie de l’euro » ?
Sur un registre plus technique, l’éditorialiste vedette du Financial Times Wolfgang Münchau, convaincu que Syriza – comme Podemos en Espagne – est le seul parti de Grèce à avoir compris l’ampleur de la crise de la dette, constate que « la Grèce n’a eu d’autre choix que d’accepter un accord dans lequel les Allemands l’ont emporté, sur chacun des enjeux décisifs ». Mais il rappelle que « l’accord dure quatre mois, ce qui laisse du temps pour engager la bataille qui importe le plus : fixer la trajectoire de long terme des positions budgétaires grecques ».
On en revient donc aux débats sur le surplus budgétaire, mais aussi et surtout à la restructuration de la dette – volet tellement tabou à Bruxelles, qu’il a été mis de côté pendant tout le premier mois des négociations. Sur ce front, « les choix ne sont pas binaires : l’austérité à l’allemande, contre le Grexit. Des options intermédiaires existent, qui sont bien plus pertinentes », juge Münchau, qui plaide tout à la fois pour un effacement d’une partie de la dette, ou encore l’émission d’obligations par Athènes, dont le remboursement dépendrait de l’évolution de la croissance du pays (deux revendications de Syriza), mais aussi d’une extension des durées de remboursement des prêts consentis à la Grèce (ce que souhaitent nombre de ministres de l’Eurogroupe).
Dans un texte plus directement politique publié par Libération, les philosophes français Étienne Balibar et italien Sandro Mezzadra en appellent aux mouvements sociaux : « Aussitôt, Syriza a dû faire face au régime de pouvoir existant en Europe et subir toute la violence du capital financier. Il serait naïf de croire que le gouvernement grec puisse à lui seul ébranler ces limites. Même un pays pesant beaucoup plus lourd que la Grèce aux points de vue démographique et économique n’en aurait pas eu les moyens. (…) Ce n’est pas à nous qu’on apprendra qu’un résultat électoral ne suffit pas, et d’ailleurs Alexis Tsipras lui-même n’en a jamais fait mystère. Il faut que s’ouvre un processus politique, et pour cela que s’affirme et se structure un nouveau rapport de forces sociales en Europe. » À leurs yeux, oui, Tsipras a bien fait de « céder », en apparence, pour « gagner du temps et de l’espace » – c’est-à-dire pour que les luttes sociales s’intensifient sur le terrain, pour que Podemos prenne le pouvoir en Espagne, etc.
Mais les compromis corsés du texte de vendredi risquent de laisser des traces. Une question décisive va rapidement se reposer : Syriza a-t-elle l’intention de « caler le pied de table », ou de « renverser » la table, pour reprendre l’alternative de l’économiste Frédéric Lordon ? Les regards se tournent forcément, une fois de plus, sur la zone euro, et sa capacité à répondre aux crises en cours. « La Grèce est la pointe avancée de la décomposition d’une union monétaire insoutenable dans son architecture actuelle, que les acteurs les plus puissants sont pourtant décidés à conserver, puisqu’elle sert jusqu’à présent leurs intérêts. Du temps est sans cesse acheté, mais en imposant des politiques économiques poussant dangereusement à la déflation. Ce n’est que dans les prochains mois que nous saurons si Syriza se conformera à cette logique, ou s’il finira par s’y dérober », écrivent les universitaires français Fabien Escalona et Nicolas Gonzales sur Slate.
Les adversaires de l’euro estiment que leurs arguments se trouvent renforcés, depuis le compromis de vendredi, qui ne règle aucun des problèmes sur la table. Intellectuel classé à l’aile gauche de Syriza, Stathis Kouvelakis avait déjà exprimé ses réserves en milieu de semaine dernière, dès l’envoi par les Grecs de la « demande d’extension » du programme, à l’origine de l’accord de vendredi. Ce professeur de philosophie à Londres écrit : « Ces arguments rassurants entendus ces dernières années – sur le « bluff » des Européens, sur la possibilité de rejeter l’austérité à l’intérieur du cadre fixé par la zone euro, sur la différence à faire entre un accord pour un prêt, et un mémorandum (de la Troïka, ndlr), sur les solutions dans l’esprit de la conférence de Londres de 1953 sur la dette allemande (c’est-à-dire pour une restructuration favorable aux débiteurs, avec l’accord des créanciers) – en clair, tous ces éléments constitutifs d’un récit qui voudrait qu’il existe un « bon euro », se sont effondrés. »
De son côté, l’économiste français Jacques Sapir se félicite en partie de l’accord trouvé vendredi, qui a le mérite d’apaiser les choses – pour un temps. « Une crise moins d’un mois après l’accession au pouvoir eût provoqué un chaos probable », écrit-il. Mais il reconnaît que rien n’a changé, en ce qui concerne le fardeau de la dette grecque (175 % de son PIB). « L’Allemagne ne peut pas céder, ni non plus le gouvernement grec. Ceci implique que l’on va vers un nouvel affrontement, à moins que d’ici-là se dessine une « alliance » anti-allemande. C’est ce qu’espère Tsipras, et sur ce point il a tort. Les gouvernements français et italien sont en réalité acquis aux idées allemandes. » Et Sapir de conclure : « Mieux vaut utiliser ces quatre mois gagnés de haute lutte pour se préparer à l’inévitable, c’est-à-dire à une sortie de l’euro. »
En réaction aux pressions anti-euro de l’aile gauche de Syriza (aux côtés de Kouvelakis, Costas Lapavitsas, par exemple), d’autres en reviennent au mandat confié par les électeurs grecs à Syriza en janvier. « Alexis Tsipras aurait-il été élu si son parti avait adopté avant les élections la stratégie de rupture avec l’Europe que plusieurs, au sein de Syriza, préconisaient ? Le peuple grec aurait-il soutenu aussi fortement, avant et surtout après les élections, un programme ayant pour horizon immédiat la sortie de l’euro et/ou de l’UE ? » s’interroge Dimitris Alexakis, traducteur et animateur d’un lieu de création à Athènes, sur son blog (en français).
« Les électeurs se sont prononcés en faveur d’une option différente de celle que prônait « l’aile gauche » de Syriza. La proposition majoritaire avait sans doute nombre d’ambiguïtés et d’angles morts (la proposition d’une sortie de l’euro ne comporte-t-elle pas, elle aussi, d’énormes zones d’ombre ?), c’est pourtant bien sur cette proposition que nous nous sommes prononcés en votant », poursuit-il. « Moins que de « capitulation », il faudrait peut-être parler de « clarification » : la pièce qui se jouait jusqu’alors en coulisses, avec les gouvernements grecs précédents, se joue à présent au grand jour, sous les yeux des peuples », avance-t-il, avant de conclure : « Nous avons besoin de temps et nous ne pouvons pas revenir en arrière. »
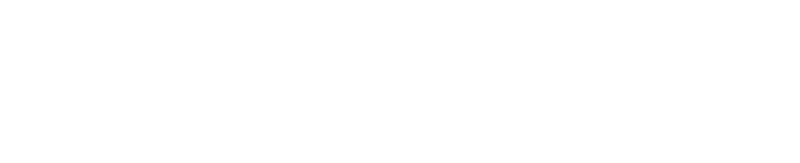
Soyez le premier à poster un commentaire.