Derrière le brevet, la biopiraterie
Paru dans n°86 de Confluences 81
Qui achète une pomme Pink Lady sur un marché ou dans une grande surface, apporte son obole à la Dole Food Company, société américaine tentaculaire de l’alimentation avec filiales dans le monde entier, qui a « inventé » ce fruit il y a quelques années avant de le faire breveter pour le monde entier. Tout arboriculteur cultivant le pommier portant la Pink Lady doit donc reverser à la société américaine des droits d’usage logiquement répercutés sur le client. Évidemment l’invention de cette pomme ne finalise pas une recherche sur le goût mais sur sa résistance au transport, sa faculté de mûrir après sa récolte et à des critères de couleurs censés attirer le regard de l’acheteur selon des normes définies par des agences de communication. Le cas n’est pas unique, qu’il s’agisse de pommes, de tomates, de concombres, de pommes de terre ou de melons : le brevetage du vivant alimentaire progresse. Le processus est d’une grande simplicité : on invente une nouvelle variété d’un fruit ou un légume en modifiant une variété existante, on la fait breveter et ensuite il ne reste plus, comme le marché international repose entre les mains de quelques sociétés, qu’à orienter progressivement la production et la commercialisation vers ces variétés-là, en organisant le dépérissement des autres. Il suffit de bien organiser la communication. Pour les pommes, il n’en reste au mieux qu’une douzaine sur les étals alors qu’un courageux arboriculteur de Touraine en offre 38 variétés sur les marchés, notamment le marché parisien du 12° arrondissement de Paris.
Mais les grands semenciers et obtenteurs ne limitent pas leurs efforts à la création de nouvelles variétés de fruits ou de légumes. Au prix d’une infime modification ils s’efforcent de s’emparer de variétés existantes. Ainsi, ce n’est qu’un exemple, une société américaine a tenté il y a quelques années de s’emparer d’un haricot mexicain, l’énola, en déposant un brevet sur sa multiplication et donc sur sa vente. Ce qui devait lui permettre de contrôler le marché d’un légume fort apprécié dans les États du sud des USA. Il aura fallu que la FAO et plusieurs organismes, avec l’appui du gouvernement mexicain, entament un long processus judiciaire pour que le brevet soit annulé en 2006 par les tribunaux américains. Et donc que soit rendu impossible le prélèvement de la dîme que la société Proctor imposait à toutes les importations après avoir « volé » un légume faisant partie de la richesse publique inaliénable. Quand il s’agit de végétaux « sauvages », les méthodes des semenciers et des multinationales sont plus subtiles et peuvent donc passer inaperçues avant que ce « brevetage du vivant » devienne opposable. D’autant plus que la richesse de la biodiversité, comme le rappellent le passé et le présent de l’Amérique Latine et de l’Afrique qui nous ont fourni l’essentiel de nos légumes actuels, se trouve au Sud.
Depuis la fin de l’apartheid, des équipes de sociologues et d’anthropologues sillonnent le territoire de l’Afrique du Sud. Sous cette couverture, comme ils l’on fait auparavant en Amérique du Sud et en Amérique Centrale, ils étudient attentivement les activités des guérisseurs et des cueilleurs de simples. Des activités que les changements politiques ont libérées et développées, beaucoup de peuples sud-africains redécouvrant les vertus de nombreuses plantes. Il suffit de fréquenter les marchés spécialisés de Johannesburg pour constater ce retour à la médecine végétale. Laquelle, comme partout, offre l’immense avantage d’être moins chère que les molécules des sociétés pharmaceutiques. Les équipes missionnées par les grandes multinationales de la pharmacie et de l’alimentation prélèvent, sélectionnent, rétribuent des « sorciers » sous prétexte d’études sociologiques pour qu’ils les guident à travers les espaces naturels où poussent les plantes qu’ils récoltent, avant de les vendre ou de préparer des potions qui, sans être magiques, possèdent d’incontestables vertus curatives. Notamment pour les maladies ordinaires.
Les espaces africains, tout comme la forêt amazonienne, notamment dans sa canopée, recèlent encore des trésors que les gouvernements du Sud s’efforcent de protéger contre ce que l’on appelle désormais la biopiraterie. Au Brésil, c’est le petit État du Nord du pays, l’Amapa, qui a le premier tenté de règlementer l’activité des équipes de botanistes déguisés en sociologues. Une initiative en cours d’extension, malgré les difficultés, à tout l’espace brésilien, ce qui explique que les grands laboratoires aient progressivement entrepris de s’attaquer à l’Afrique où les Etats sont plus faibles, voire inexistants.
Claude-Marie VADROT
Publié dans ALTERS ECHOS n° 21 (juillet-août 2010). C-M Vadrot est journaliste à Politis et Médiapart.
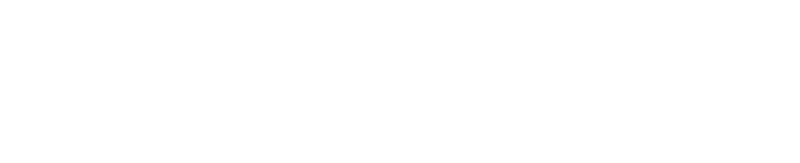
Soyez le premier à poster un commentaire.