Le deuxième stade de la crise
 Le deuxième stade de la crise
Le deuxième stade de la crise
Emilio Taddei *
La nouvelle aggravation de la situation économique et sociale dans les pays développés, durant l’été 2011, marque l’entrée dans un second stade de la crise mondiale, qui avait éclaté 4 ans plus tôt.
Ce nouveau stade est notamment caractérisé par les attaques spéculatives contre les dettes souveraines.
Il conduit d’abord à revenir sur la nature profonde de cette crise, et conduit à admettre l’imprédictibilité de son évolution ; ensuite, il mène à la nécessité de proposer des perspectives de moyen terme, à l’horizon des 5 ou 10 prochaines années1 ; enfin, il incite à proposer d’expliciter diverses urgences2.
La nature de la crise contemporaine
Presque tout le monde admet aujourd’hui, bien au-delà des seuls
rangs altermondialistes, le caractère systémique de la crise contemporaine. Encore reste-t’il à préciser ce qu’on entend par là et, d’abord de quel système on parle : la crise contemporaine est-elle celle du seul système économique et financier, qu’on pourrait analyser isolément des autres dimensions de la vie collective, les autres dimensions étant préservées ou, du moins, subordonnées, sans possibilité d’influence en retour, si bien que l’on pourrait s’en tenir à la seule analyse économique et en faire un sujet pour les seuls économistes ? Ou bien vise-t’on plus globalement un système, comportant toutes les dimensions de la vie en société ?
Même si l’économisme a encore la vie dure, aussi bien chez les néo-libéraux que chez les archéo-marxistes, il existe désormais un assez large consensus pour ne pas se cantonner à l’économie et à reconnaître le caractère multidimensionnel de la crise contemporaine : celle-ci est, de façon de plus en plus évidente, tout à la fois économique et financière, sociale, écologique, politique et géopolitique, d’où une crise morale et des valeurs, conséquente à toutes les précédentes…. On finit ainsi par parler de crise globale ou de civilisation. 
Mais, à partir de là les différents analystes n’accordent pas la même pondération à ces différentes dimensions, ce qui peut les conduire à des appréciations assez différentes sur les perspectives à venir et les issues possibles et souhaitables.
En effet, chacune des crises spécifiques à un sous-système particulier obéit à sa temporalité propre liée à des contradictions bien spécifiques : son degré de mûrissement, et donc d’urgence, n’est pas initialement le même, tant du moins que la crise de chaque sous-système n’entre pas trop fortement en résonance avec les autres.
Pour simplifier une réalité d’une formidable complexité, on reprendra les 5 dimensions principales énumérées ci-dessus, mais il va sans dire que l’on pourrait aussi bien utiliser une typologie plus restreinte ou, au contraire, plus large, ne serait ce qu’en regroupant ou en subdivisant certaines des dimensions retenues :
– La crise économique et financière est d’abord celle de l’économie d’endettement3 : cette dernière est née, il y a environ 30 ans, dans un contexte d’érosion du leadership américain et de chocs pétroliers. Elle a été marquée par le triomphe de ce qu’on a appelé, de façon à notre sens superficiel, le « néo-libéralisme », c’est-à-dire la libération sans règle des mouvements de marchandises et de capitaux, par delà les frontières nationales ou continentales (dans le cas d’unions douanières comme la Communauté européenne d’origine). Avancer que nous sommes en présence d’une crise économique plus profonde que celle de l’endettement est une hypothèse sans doute fondée : pour ce qui nous concerne elle vise au-delà de ses aspects financiers l’ensemble du processus de dérégulation entrepris dès les années 1970 et remet en question l’absence de contrôle des mouvements de capitaux et de marchandises. Aller encore au-delà dans la remise en question en considérant que la rupture actuelle atteint définitivement toute forme de capitalisme, constituant ainsi la crise finale de ce dernier, est une question qui demeure ouverte, d’autant plus qu’elle est récurrente… depuis les années 1850 (cf. la correspondance de K. Marx de cette époque).
– La crise sociale est celle de l’inégalité croissante des revenus et surtout des patrimoines, d’une incontestable paupérisation relative et d’une précarisation du plus grand nombre.
Dans les pays développés4, ceci nous ramène en 30 ans, à gommer 60 ans de conquêtes sociales et à retrouver une situation objective néo-marxienne en termes d’antagonismes, si ce n’est de luttes, de classes.
Sans doute, les frontières sociales ne sont plus exactement celles du XIXème ou même du XXème siècle : d’un côté, il faut distinguer de 90 à 99% des salariés, qui vivent essentiellement de la location de leurs force de travail, alors qu’1% perçoit principalement les profits de leur capital financier, intellectuel et/ou relationnel (pour reprendre la célèbre analyse de P. Bourdieu)5; de l’autre, il faut observer la part de plus en plus restreinte des profits des entreprises, surtout petites et moyennes, qui pourraient servir à financer de nouveaux investissements productifs, au bénéfice des profits financiers, qui fournissent la base de toutes les spéculations.
 – La crise écologique est celle engendrée par un développement insoutenable, en termes de réchauffement du climat, de perte de la bio-diversité et, peut être encore plus, à court terme, par une chute dramatique de la reproduction de l’ensemble des espèces vivantes, y compris la notre, sur notre planète : c’est ainsi plus de deux siècles de productivisme, qui se trouve nécessairement remis en cause, l’idéal étant évidemment que la transformation de nos modes de production, de transport, de logement et de consommation s’effectue le plus rapidement possible et par une voie négociée, plutôt que trop tardivement et de manière brutale, imposée par de futures catastrophes et les angoisses collectives qu’elles ne manqueront pas de générer.
– La crise écologique est celle engendrée par un développement insoutenable, en termes de réchauffement du climat, de perte de la bio-diversité et, peut être encore plus, à court terme, par une chute dramatique de la reproduction de l’ensemble des espèces vivantes, y compris la notre, sur notre planète : c’est ainsi plus de deux siècles de productivisme, qui se trouve nécessairement remis en cause, l’idéal étant évidemment que la transformation de nos modes de production, de transport, de logement et de consommation s’effectue le plus rapidement possible et par une voie négociée, plutôt que trop tardivement et de manière brutale, imposée par de futures catastrophes et les angoisses collectives qu’elles ne manqueront pas de générer.
– La crise géopolitique est celle de la perte d’hégémonie du monde anglo-saxon. Cette hégémonie est pourtant vieille d’un quart de millénaire (en 1752, la fin de la guerre de 7 ans assoit durablement la domination anglaise sur le monde ; la transition vers la domination nord-américaine s’effectue ave un minimum de turbulences durant l’entre deux guerres, du fait de la proximité culturelle entre les deux pays et leurs élites). Mais la crise de cette hégémonie, il est vrai trop souvent annoncée prématurément dans le passé est désormais illustrée aussi bien par les terribles échecs de Bush que par la « (Jimmy)-cartérisation » de B. Obamah. Ce que ni Napoléon Bonaparte, ni Bismarck, ni Staline ou Hitler n’ont réussi, s’impose progressivement du fait du rythme du rattrapage des pays émergents, en particulier asiatiques. Les conditions objectives d’antagonismes entre impérialismes déclinants et impérialismes émergents, aiguisées par les déplacements des mouvements de capitaux, se développent à un rythme accéléré, d’une façon qui rappelle dangereusement le début du siècle précédent. Là encore, il vaudrait mieux acter rapidement de manière concertée un nouvel équilibre mondial (au sens où on parlait au XVIIIème siècle d’équilibre européen), avant que des conflits devenus incontrôlables ne l’imposent : rappelons que nous nous sommes à l’ère des armes nucléaires, chimiques et bactériologiques et de leur dissémination…
– La crise politique est celle de la démocratie de délégation, vieille aussi de plus de deux siècles et de ses formes partidaires, un peu plus récentes, dont la primaire socialiste nous a donné un intéressant palliatif… De moins en moins représentatives (il faudrait une conférence entière pour le disséquer) et nulle part réellement participatives (participer à quoi précisément ? Si ce n’est à l’ensemble des étapes, qui scandent le processus continu de décisions collectives), les formes anciennes de la démocratie s’usent, alors que ses aspirations fondamentales s’universalisent progressivement, en Europe, en Amérique, en Asie, comme désormais dans le monde arabe. C’est qu’une démocratie réellement coopérative, où tous les citoyens pourraient œuvrer ensemble, avec les responsables élus6, à toutes les étapes des activités collectives, est encore à inventer.
Chacun de ces sous-systèmes et leur crise respective interfèrent évidemment avec celle des autres sous-systèmes.
On se contentera d’en proposer quelques exemples évidents :
– le premier se situe entre l’économique et le social : ce sont les dérégulations du « néo-libéralisme », s’appuyant sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication qui ont renforcé le pouvoir de marchandage des facteurs mobiles (capital financier, mais aussi culturel et relationnel) sur les facteurs fixes (travail moyennement ou peu qualifié et capital fixe), dans la répartition des fruits de la croissance. Le creusement des inégalités de revenus et encore plus de patrimoine en est la conséquence directe7 ; en retour, celles-ci bloquent la demande solvable des ménages et, au-delà, les investissements productifs qui devraient en découler, ne trouvant des débouchés suffisants que par un recours de plus en plus démesuré à l’endettement, jusqu’au déclenchement de la crise actuelle.
– Un deuxième exemple est l’interférence entre la libération des mouvements de capitaux et le basculement géopolitique en cours, qui nous ramène inexorablement à la montée des conflits entre les impérialismes déclinants (nord-américains et européens) et les impérialismes émergents (principalement asiatiques), qui caractérisent les périodes du capitalisme qui favorisent les mouvements internationaux de capitaux, comme ceux qui, il y a un siècle, précédèrent 1914. 
– On pourrait encore développer un autre exemple des interférences entre les différentes dimensions de la crise globale, quand face à une crise sociale pérenne, on ne sait répondre à la désespérance sociale que par le développement de politiques intérieures autoritaires, de type néo-orwélienne8 ;
– ou encore quand les mouvements spéculatifs, notamment dans le domaine foncier s’accompagne du recul de l’état de droit, devant le crime organisé dans de nombreux pays, dont le nôtre ;
– ou encore dans le saccage de la planète, entraîné par les placements spéculatifs, sans foi, ni loi…
Il résulte de l’interaction dynamique entre les crises de ces différents sous-systèmes que l’évolution globale du système planétaire comporte de nombreuses non-linéarités, qui rendent caduques les vieilles habitudes de prévision par extrapolation, qui supposaient au moins implicitement que les principales évolutions étaient linéaires. Or, nous sommes évidemment dans un moment de l’histoire de notre planète qui relève évidemment d’une approche en termes de chaos, qui n’est pas moins déterministe, mais qui l’est en des termes non prédictibles au-delà des prochaines années, et peut être même des prochains mois.
Si l’approche présentée jusqu’ici est correcte dans ses grandes lignes, l’action citoyenne doit se concentrer sur deux grandes tâches : d’une part, définir des perspectives de moyen terme (5 à 10 ans), capables de faire sens pour un nombre maximum de citoyens, à travers le monde ; d’autre part, se doter de propositions d’urgence, en particulier contre l’aggravation la plus immédiate de la crise, hic et nunc, qui est celle d’une vague de faillites bancaires en Europe.
Des perspectives pour l’action citoyenne :
Il nous faut, collectivement, des étoiles auxquelles accrocher notre charrue. Autrement dit, il nous faut donner du sens (c’est-à-dire à la fois une signification et une direction) à nos actions citoyennes journalières. Ceci ne relève plus, comme aux siècles précédents d’utopies, qui étaient comme autant de descriptions de futurs paradis sur terre. Par contre, il est possible de dessiner des perspectives crédibles dans quelques domaines fondamentaux, qui dessineront à l’horizon de la décennie un autre système global, dépassant les crises du système actuel. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur d’innombrables travaux collectifs menés sur tous les continents et qui ont été largement discutés durant ces premières années de la crise contemporaine, à travers internet et de nombreux forums sociaux. Il est évidemment impossible d’en rendre ici un compte rendu complet, mais nous voudrions insister sur deux ou trois des ces perspectives, le débat permettant éventuellement d’en approcher d’autres. Nous retiendrons donc d’abord« l’accès aux droits et l’impératif démocratique »9 ; ensuite, ce que pourrait être une nouvelle gouvernance mondiale10 ; enfin, nous chercherons à définir ce qui pourrait être un nouveau paradigme des échanges internationaux, sous le terme de « fair trade », qui subordonne ceux-ci à l’adoption de régulations efficaces contre les 4 grandes formes de dumping : monétaire, fiscal, social et écologique,
Cette dernière approche pourrait avoir le mérite de rapprocher le bloc des « gauches de gauche », qui semble se fissurer entre tenants de la « démondialisation » et altermondialistes.
Tout cela, et bien d’autres perspectives, pourront faire l’objet de débats, soit oraux, soit ultérieurement par écrit. Mais l’histoire nous rattrape et je souhaiterais consacrer la troisième partie de cet exposé aux questions d’urgence.
L’urgence immédiate, la socialisation du crédit :
 Ce n’est pas nous qui guidons l’actualité ! Or, l’agenda de ces jours-ci est dominé par les évènements financiers : la reconnaissance de l’insolvabilité grecque (pour 50% de son montant nominal, ce qui paraît un pourcentage minimal) et sa traduction dans les bilans bancaires. Faute de s’être doté depuis 2008 des moyens anti-spéculatifs nécessaires – pour reprendre l’heureuse contre pétrie d’Eva Joly « on a changé le pansement, plutôt que penser le changement » -, nous risquons de connaître dans les prochains jours le déchaînement de la finance, sans doute d’abord contre le Portugal et surtout l’Italie, en attendant d’autres pays de la zone euro, et peut être la France : dans la moitié de ceux-ci, il existe déjà une décote de quelques 10% de l’ensemble des créances, même les meilleures. Après la chute de Dexia, il a fallu reconnaître au niveau européen, que de nombreuses banques ne pourront pas résister à ces nouvelles et brutales dépréciations d’actifs, sans augmentation considérable de leur capital. Comme pour une bonne part d’entre elles, cette augmentation ne peut venir des financiers privés (lesquels seraient assez fous pour investir en ce moment dans les banques menacées de faillite, alors même qu’elles ne se prêtent même plus entre elles au jour le jour ?), c’est donc à nouveau l’argent public qui va être massivement sollicité, comme en 2008 : l’argent du public, alors même qu’on le pressure déjà, à travers des cures d’austérité simultanées, dont le premier effet évident – regardez les chiffres grecs ou britanniques – déclenche une nouvelle chute de l’activité et donc une aggravation des déficits et de l’endettement publics que l’on prétend ainsi combattre !
Ce n’est pas nous qui guidons l’actualité ! Or, l’agenda de ces jours-ci est dominé par les évènements financiers : la reconnaissance de l’insolvabilité grecque (pour 50% de son montant nominal, ce qui paraît un pourcentage minimal) et sa traduction dans les bilans bancaires. Faute de s’être doté depuis 2008 des moyens anti-spéculatifs nécessaires – pour reprendre l’heureuse contre pétrie d’Eva Joly « on a changé le pansement, plutôt que penser le changement » -, nous risquons de connaître dans les prochains jours le déchaînement de la finance, sans doute d’abord contre le Portugal et surtout l’Italie, en attendant d’autres pays de la zone euro, et peut être la France : dans la moitié de ceux-ci, il existe déjà une décote de quelques 10% de l’ensemble des créances, même les meilleures. Après la chute de Dexia, il a fallu reconnaître au niveau européen, que de nombreuses banques ne pourront pas résister à ces nouvelles et brutales dépréciations d’actifs, sans augmentation considérable de leur capital. Comme pour une bonne part d’entre elles, cette augmentation ne peut venir des financiers privés (lesquels seraient assez fous pour investir en ce moment dans les banques menacées de faillite, alors même qu’elles ne se prêtent même plus entre elles au jour le jour ?), c’est donc à nouveau l’argent public qui va être massivement sollicité, comme en 2008 : l’argent du public, alors même qu’on le pressure déjà, à travers des cures d’austérité simultanées, dont le premier effet évident – regardez les chiffres grecs ou britanniques – déclenche une nouvelle chute de l’activité et donc une aggravation des déficits et de l’endettement publics que l’on prétend ainsi combattre !
Le fait que le crédit soit un bien public – ce qui est indéniable – ne justifie en rien la récurrence des mesures de soutien sans contrepartie, qui ont permis de perpétuer les pratiques spéculatives, désormais déchaînées contre les Etats les plus faibles ! Une réaction massive de l’opinion doit donc se manifester dans les plus brefs délais. Il est urgent de populariser le slogan de la « socialisation du crédit », qui paraît faire consensus chez la plupart des économistes progressistes. En attendant de se généraliser, celle-ci devrait d’abord concerner tous les établissements faisant appel aux capitaux publics, avant qu’une loi ne vienne le généraliser dans les conditions propres à chaque pays.
Mais pour que cette idée, qui rompt avec la pratique déjà essayée en 2008 de nationalisation partielle et temporaire, s’impose et permette la mobilisation la plus large – sur ce sujet, on ne manquera pas d’alliés de circonstances -, il faut en préciser deux modalités essentielles, sans tomber dans une technicité, qui rebute évidemment le plus grand nombre :
– en premier lieu, la stricte séparation des activités commerciales et des activités spéculatives, sur le modèle réussi de Roosevelt, durant la Grande Dépression des années 1930 ;
– en second lieu, la mise en place auprès du directoire de la banque socialisée, d’un conseil de surveillance quadripartite11, composée des représentants de l’Etat (avec une golden share, autrement dit, un droit de veto, puisque celui-ci est le garant ultime de son capital), les représentants élus des salariés de la banque, ceux des déposants et, enfin ceux des clients (ménages et entreprises). Les délibérations de ce conseil de surveillance auraient un caractère public.
On voit bien qu’il s’agit alors de créer une gouvernance innovante, visant à synthétiser les avantages de la banque nationalisée et de la banque coopérative, et qui justifie pleinement le terme d’établissement socialisé.
* Emilio Taddei est sociologue et politologue.
Il est membre du groupe d’études sur l’Amérique latine (GEAL) – Buenos Aires
Notes :
1. Dans ce débat, nécessairement pluraliste, nous nous situerons dans une perspective altermondialiste, proche de celle de G. Massiah dans son livre de 2010, même si nous serons amenés à le compléter ou l’amender sur différents points.
2. En particulier, l’actualité conduit à préciser les termes de la bataille à venir sur la recapitalisation des banques européennes.
3. Bien entendu, toute économie capitaliste (et autre) connaît des phénomènes d’endettement. Ce qui est ici visé, est le fait que l’endettement soit devenu le moteur principal de la croissance de la demande globale, faute de pouvoir d’achat salarial ou de vagues suffisantes d’investissement productif. Quant aux excédents extérieurs, il s’agit évidemment toujours d’une solution locale, qui a pour contrepartie le déficit d’autres pays et ne peut donc jamais suffire à assurer l’expansion de la demande globale. C’est, en ce sens que le cas allemand n’est évidemment pas exemplaire, sans même parler de leur inexorable implosion démographique.
4. Dans les pays émergents, les inégalités s’accroissent également, du fait de la mondialisation dérégulée, mais le rythme de rattrapage est tel qu’il en résulte une amélioration, en termes absolus, de la situation du plus grand nombre, ce qui explique que les régimes politiques en place bénéficient depuis au moins une décennie d’une stabilité conséquente, que ce soit en Chine, en Inde, au Brésil, en Afrique du Sud, en Turquie, etc.
5. Entre 1 et 10% des salaires peuvent être considérés comme hybrides, relevant dans des proportions variables des fruits du travail et des capitaux intellectuels et relationnels.
6. Et peut être pour une part tirés au sort, comme on le fait pour les jurés d’Assises, de façon à éviter une confiscation par les « carriéristes » de la politique.
7. Parfois renforcée par une volonté délibérée du pouvoir d’Etat, via une fiscalité anti-reditributrice, notamment dans les pays anglo-saxons ou en France.
8. Ne serait ce que pour ces raisons l’emploi immodéré du qualificatif de néo-libéral est proprement mystificateur pour décrire des situations autoritaires dans l’ordre intérieur ou néo-impérialistes dans l’ordre extérieur.
9. A cet égard, nos idées sont proches de celles avancées par G Massiah dans son livre, proposant « une stratégie altermondialiste », particulièrement dans son chapitre 3.
10. Nous formulons dans une première annexe, 10 propositions « pour une régulation mondiale légitime et efficace », dont la plupart ont déjà été avancées dans la mouvance altermondialiste, mais qui s’efforcent ici de constituer un système d’ensemble.
11. Cette proposition s’inspire de la loi de réforme des caisses d’épargne (loi Taddei du 31 juillet 1983) qui a permis de sauver celles-ci au début des années 80 du naufrage que venait de connaître leurs consoeurs américaines) et qui a donné satisfaction, avant qu’une privatisation hautement idéologique ne les entraîne dans les difficultés que ce réseau a connu depuis lors.
Annexe 1 : Pour une régulation mondiale légitime et efficace.
Face à la crise de la mondialisation, caractérisée par l’hégémonie US et l’accumulation financière, quelle issue ?
Celle-ci ne doit pas être le retour à un fractionnement du monde, évidemment lourd des pires conflits. Les drames humains, les urgences écologiques et les risques géo-militaires, nous le rappellent dramatiquement tous les jours : nous n’avons qu’une seule planète, dont nous sommes tous solidairement responsables. C’est pourquoi, l’altermondialisme n’est pas un anti-mondialisme, mais l’actualisation permanente du vieil internationalisme humaniste d’un Jaurès : il en partage les valeurs fondamentales, mais il ne considère ni la nation, ni aucune autre sorte de souveraineté comme pertinente pour réguler l’emboîtage de communautés de vie et de destin, qui forment autant de communautés politiques différenciés, de la planète jusqu’au quartier et au village.
Elle ne peut espérer, à un horizon crédible, la mise en place d’un gouvernement planétaire, dont l’utopie humaniste est hors de portée, même si nous ne devons pas cesser de promouvoir l’idéal d’une citoyenneté mondiale. Par contre, à défaut de convaincre toutes les puissances et toutes les consciences de faire « du passé, table rase », on peut espérer (devant les risques d’éclatement de crises en tout genre), peut être plus vite qu’on ne le croit parfois, constituer une large alliance pour proposer une nouvelle régulation mondiale, légitime et efficace. Celle-ci devrait s’appuyer sur la Charte des Nations Unies, la Déclaration Universelle des droits de l’homme et les valeurs essentielles de paix, de solidarité internationale, de développement durable et de diversité culturelle, en s’appuyant sur tous les efforts sincères de coopération mondiale et régionale, menés depuis 60 ans. Pour cela, les institutions existantes ne doivent pas être niées dans leur principe, car elles ont vocation à créer les conditions d’une régulation concertée et anti-hégémonique des grands problèmes mondiaux. Mais, elles doivent être aujourd’hui critiquées, sans relâche et sans complaisance, pour leur absence ou leur insuffisance de légitimité et, par là-même d’efficacité, ce qui suppose, moins leur disparition que leur transformation.
Il faut donc que le mouvement altermondialiste sache convaincre la conscience universelle, qu’entre régression et utopie, il est possible de définir une autre régulation mondiale, à la fois légitime et efficace, compte tenu de ce que l’efficacité ne pourra résulter que de sa nouvelle légitimité, fondée sur la promotion des droits humains et des libertés. Cette nouvelle régulation ne peut reposer que sur une stratégie de transformation des institutions existantes. Mais, en même temps, elle est toute autre chose qu’une simple addition de réformes ponctuelles, qui seraient l’affaire de technocrates et d’experts internationaux, et elle a besoin, pour réussir, de la participation du plus grand nombre des citoyens du monde, de leurs mouvements sociaux et culturels, de leurs organisations syndicales et de leurs élus légitimes, qu’ils soient nationaux ou locaux. Ce sont, eux tous, qui doivent s’emparer, en toute circonstance désormais, des principes essentiels d’une nouvelle régulation mondiale, légitime et efficace, et de toutes les conséquences qui en découlent.
Cette nouvelle régulation pourrait reposer sur 10 principes essentiels, dont découlent autant de conséquences concrètes :
1. Les institutions économiques, financières et commerciales sont subordonnées aux instances politiques légitimes.
Conséquences concrètes : L’intégration des institutions économiques mondiales (FMI, Banque Mondiale, OMC, BRI, OCDE), dans le système des Nations Unies, doit être effective. Ceci signifie le respect de leur Charte, de la Déclaration Universelle ; des procédures de décision conformes (cf. infra) ; la définition de leur rôle et leur contrôle par les instances légitimes (Assemblée Générale et Conseils de Sécurité : cf. infra).
2. Ces instances assurent une répartition multilatérale équitable à tous les peuples du monde.
Conséquences concrètes : La création d’un Conseil de Sécurité économique, social, culturel et environnemental (2 ESC, en anglais). Il serait composé de 10 membres renouvelables tous les 10 ans (dont 2 pour l’Afrique, 1 pour l’Amérique du Nord, 1 pour l’Amérique latine, 3 pour l’Asie, 2 pour l’Europe, et 1 pour et l’Océanie), comprenant les pays (ou groupements les plus importants de chaque continent) et de 15 autres membres, élus tous les 2 ans, par l’Assemblée Générale. Chaque membre représenterait un Etat ou un groupe d’états (tel que l’Union Européenne). Ce « 2 ESC » se substituerait aux différents clubs de pays riches du type G7, G8, G20 etc. Le PNUD, la CNUCED, la BRI et l’OCDE lui sont rattachées.
En cas de conflits entre les normes édictées par diverses agences spécialisées, le 2 ESC arbitre, après avis de l’assemblée économique, sociale, culturelle et environnementale (cf. infra).
Toutes ses décisions doivent être prises, suivant le principe de double majorité et à l’exclusion de tout droit de veto : elles ne sont validées que si elles sont adoptées par une majorité de ses membres, représentant la majorité des populations des pays membres, ce qui garantit un équilibre entre les pays les plus peuplés et les moins peuplés.
3. La société civile et les mouvements sociaux mondiaux doivent être associés de façon permanente à toutes les décisions des instances mondiales
Conséquences concrètes : La création d’une Assemblée économique, sociale, culturelle et environnementale, réunissant les représentants des organisations patronales, syndicales, culturelles (représentant les milieux artistiques et scientifiques) et environnementales, ainsi que les ONG humanitaires. Celles-ci devraient être obligatoirement consultées, avant toute décision de l’Assemblée Générale et des Conseils de Sécurité. Elle dispose d’un pouvoir d’initiative, pour demander à l’Assemble Générale et aux conseils de sécurité de délibérer sur toutes les questions qui leur semblent le justifier et des moyens d’études du PNUD, de la CNUCED et de l’OCDE.
4. La primauté de l’Assemblée Générale des Nations Unies
Conséquences concrètes : L’Assemblée Générale a seule pouvoir, pour édicter des normes et des recommandations, à son initiative, ou à celle de l’Assemblée économique, sociale et environnementale. Toutes ses décisions sont prises, suivant le principe de double majorité.
5. Régulation mondiale et séparation des pouvoirs
Conséquences pratiques : Les conseils de sécurité prennent toutes les décisions d’application, qui découlent des principes de la Charte et des résolutions de l’Assemblée Générale. De son côté, la Cour Pénale Internationale doit disposer d’une compétence universelle et obligatoire, englobant l’ensemble des tribunaux ad hoc, et d’une totale indépendance, à l’égard des autres instances mondiales, comme des états nationaux. Ses jugements sont assortis de sanctions, dont l’exécution relève, suivant les cas, de l’un et/ou l’autre des conseils de sécurité (opérations militaires et/ou sanctions économiques) ou d’une compétence universelle d’application des instances judiciaires de tous les pays membres.
6. Légitimité et cohérence de l’ensemble de la régulation mondiale
Conséquences pratiques : Le conseil de sécurité rapproche sa composition et son mode de décision de ceux du « 2 ESC », en vue de leur fusion. Les pouvoirs de sanction appartiennent aux deux conseils de sécurité, dans leur domaine respectif de compétences.
7. Le monopole de l’utilisation légitime des forces armées appartient à l’ONU :
Conséquences pratiques : L’ensemble des forces armées, mises à la disposition d’organisations internationales ou mondiales (Otan, casques bleus, etc.) sont regroupées et placées sous la seule responsabilité du conseil de sécurité des Nations Unies.
8. Le financement du développement durable est assuré par l’émission de Droits de Tirage Spéciaux (DTS) et de taxes globales.
Conséquences pratiques : Le Fonds Monétaire International, agence spécialisée de l’ONU, applique les normes édictées par l’Assemblée Générale, ainsi que les décisions du « 2 ESC », prises après délibération de l’Assemblée économique, sociale, culturelle et environnementale. En particulier, il offre, par une émission suffisante de DTS, le financement de l’ensemble des projets de développement durable, ainsi que l’annulation de la dette des pays pauvres, en relation avec les banques régionales de développement. Il peut mettre en place une fiscalité sur les mouvements internationaux de capitaux, en particulier sur les plus spéculatifs et les plus déstabilisateurs d’entre eux, ainsi que sur les activités polluantes. Il contribue à une évolution raisonnée des parités monétaires, par une contribution équilibrée des pays excédentaires et déficitaires.
9. Les échanges de marchandises (biens et services) sont régulés dans une perspective de développement durable de la planète et de justice pour tous les peuples.
Conséquences pratiques : L’organisation mondiale du commerce est assurée par une agence spécialisée de l’ONU, qui exerce des compétences déléguées, et met en place, en tant que de besoin, des politiques régulatrices, afin que l’élargissement des échanges assure le développement des biens publics mondiaux, la souveraineté alimentaire et sanitaire de tous les pays membres, ainsi que leurs activités émergentes, de même que l’ensemble des missions assurées par les autres agences spécialisées : droit du travail, préservation de l’environnement, etc..
10. Stratégie pour un développement planétaire durable
Conséquences pratiques : La préparation des délibérations environnementales, de portée mondiale, est faite conjointement par les deux assemblées générales. Après délibération de l’assemblée économique, sociale, culturelle et environnementale, les normes sont adoptées par l’assemblée générale. Le « 2 ESC » est chargé de leur mise en œuvre, avec l’ensemble des agences spécialisées (FAO, OMS, BIT, UNICED, etc). Il établit une fiscalité écologique sur les émissions de CO2 et les déchets nucléaires : le produit de celle-ci sert pour une part à indemniser les travailleurs pénalisés par cette fiscalité et pour partie à mettre en place des activités de substitution.
Annexe 2 : Le Fair Trade, où la lutte contre les « quatre dumpings »
Un des éléments les plus préoccupants de l’actuelle crise mondiale est la tentative persistante de l’ensemble des autorités officielles de maintenir le débat sur la mondialisation des échanges à un niveau purement idéologique, affirmant un libre échangisme, qu’ils pratiquent d’ailleurs inégalement et de façon sélective (suivant les secteurs et les pays concernés), et rejetant comme protectionniste toute tentative de redéfinition des règles du commerce international. Cette posture a des traductions concrètes particulièrement négatives comme la tentative pathétique d’achèvement du « cycle de Doha » ou, plus largement le refus de toute remise en cause de l’OMC, et son absence de soumission à la charte des Nations Unies. Cette attitude risque même, les crises sociales se développant dans un nombre grandissant de pays, de conduire à des replis unilatéraux, lourds de régressions économiques, mais aussi politiques, géopolitiques et culturelles.
Il est donc grand temps de prendre toute la mesure du mot d’ordre « un autre monde est nécessaire », dans lequel les échanges de marchandises, biens et services, comme ceux des capitaux, relèveront non d’une pseudo-liberté, dont tout le monde sait qu’elle est pour une bonne part celle des tricheurs et peut constater tous les méfaits, mais de rapports loyaux entre l’ensemble des protagonistes : non pas du free trade, mais du fair trade.
Ce dernier n’est pas un vague slogan de compromis entre les protagonistes historiques des deux thèses, qui s’opposent depuis plus de deux siècles. Le débat était déjà récurrent au XVIIIème siècle, à propos du commerce des grains. Sur le plan théorique, il a pris sa pleine ampleur, après les essais maladroits d’Adam Smith (la théorie des avantages absolus dans la Richesse des Nations, 1776) et de Fichte (la tentation autarcique dans « l’Etat commercial isolé », 1800), avec D. Ricardo, et sa théorie des avantages comparatifs, et Fr. List, et sa recommandation d’un « protectionnisme éducateur ». La nationalité même des auteurs, respectivement britanniques , appartenant à la puissance alors hégémonique, et allemands, membres de la nation qui tente alors d’émerger, suffit de convaincre que toute théorie de l’échange international est essentiellement géopolitique. C’est pourquoi, tous ceux qui veulent prévenir les conflits entre nations développées et nations émergentes, sur une base équitable et donc finalement acceptable par tous, ont besoin d’une base normative qui dépasse l’antagonisme entre le libre-échange, qui profite aux premiers, et le protectionnisme, qui pourrait éventuellement bénéficier aux seconds , lequel antagonisme se termine toujours par les épreuves de force négatives pour l’humanité (de la guerre mondiale à l’aggravation de la dépression dans l’entre-deux guerres).
L’approche en termes de fair trade remplit justement ces conditions, en ce qu’elle résulte de toutes les expériences concrètes vécues durant ces dernières décennies, à travers le monde, par d’innombrables acteurs, trop souvent victimes de pratiques déloyales. Le point de départ d’une telle approche est que l’échange, comme la langue d’Esope, peut être la meilleure ou pire des choses. Après tout, de quoi parle-t-on ? D’échanger des baisers ou des violences ? De la circulation de médicaments ou de drogues ? D’un commerce équitable ou évidemment inégal ? Librement consenti ou résultant d’une diplomatie de la canonnière ? Partisans ou adversaires du développement des échanges devraient donc commencer par abandonner toute attitude fétichiste : à l’intérieur de chaque société, tous les échanges ne sont pas (heureusement) traités de la même façon : il en est ainsi de la vente de voitures ne respectant pas certaines normes de sécurité ; il en sera peut-être demain de même, de celles qui peuvent atteindre des vitesses généralement interdites. Ce relatif pragmatisme dans l’ordre intérieur des Etats est évidemment plus complexe à mette en œuvre dans l’ordre international, où doivent cohabiter des normes issues de convictions et de prises de conscience différentes. Il semble pourtant que puisse se dégager un consensus :
– pour une majorité de biens et de services, les échanges peuvent être favorables aux deux parties, non seulement, à ceux qui échangent directement, mais également à l’ensemble de la collectivité à laquelle ils appartiennent ;
– ce gain collectif n’est cependant partagé que si l’échange s’effectue dans des conditions « loyales », c’est-à-dire que l’un des co-échangistes ne bénéficie pas d’avantages qui ne doivent rien à la qualité de sa production, mais à des conditions monétaires, sociales, fiscales, environnementales, etc., qui ont été manipulées pour lui permettre d’offrir un meilleur rapport qualité-prix que ses concurrents étrangers.
Pour ne s’en tenir ici qu’à l’essentiel, le fil conducteur d’un authentique fair trade repose sur des échanges sans dumping dans quatre domaines majeurs : les changes, la fiscalité, le social et l’écologie :
– la forme la plus ample et la plus brutale de dumping relève des variations de change : pendant que l’on discute de chiffres derrière la virgule dans le domaine de la fiscalité ou des salaires, le cours des monnaies peut varier de 10% en une semaine, voire du simple au double d’un moment à l’autre par une décision unilatérale, sans même parler des cas de banqueroute ! A cet égard, il n’est pas utile de s’encombrer d’un débat de doctrine monétaire sur le meilleur système possible : à l’expérience, entre un système de change fixe, mais qui admet non seulement des marges de fluctuations importantes (par exemple plus ou moins 15%, autour de la parité de référence, comme c’était le cas dans les années 1992-98, à la fin du système monétaire européen), et qui de plus peut être ajusté, comme le faisait celui de Bretton Woods, d’une part, et, d’autre part, un système de change flexible, où la coordination des principales banques centrales, et éventuellement d’un FMI rénové et relégitimé, se chargerait de contrer la spéculation à court terme par des actions symétriques des pays créditeurs et débiteurs, il n’y a guère de différences pratiques . Dans les deux cas, les parités varient en fonction des données fondamentales des différentes zones (en particulier, les différentiels de productivité, comme pour tout prix relatif). A partir du moment, où le principal créancier et le principal débiteur trouveraient un modus vivendi sur le moyen terme, la question essentielle de la création nécessaire de liquidités internationales pour financer le développement durable de toutes les zones mondiales de la planète qui ne se trouvent pas dans l’une des 4 grandes régions dont la monnaie est encore crédible (dollar, euro, yen, yuan), se règlerait simplement : il suffirait d’émettre, à due nécessité, des Droits de Tirage Spéciaux (DTS). L’utilité de ces derniers, depuis longtemps en sommeil, a enfin été réveillée l’an dernier par l’urgence de faire face aux risques pays et il n’est pas douteux que le besoin s’en fera de plus en plus sentir dans mois et les années à venir. Cependant leur usage grandissant soulève encore des questions fondamentales d’objectif… et de rapports de force.
La question n’est pas de remplacer le dollar par une seule autre monnaie (DTS ou autre), hypothèse absurde par laquelle on a cherché à retarder la réponse à la question posée, mais d‘organiser, dans un monde multipolaire, la nécessaire complémentarité entre une monnaie mondiale et une multiplicité de monnaies régionales, dont les parités seront à l’abri des spéculations de marché et des manipulations d’Etats.
La seule question essentielle est celle du pouvoir de décision au FMI (qui doit faire l’objet d’une révision, pour l’instant tout à fait insatisfaisante, avant la fin 2010) et de l’abandon du monopole de veto américain, avec 17% des droits de vote, alors que les décisions se prennent à la majorité de 85% ! A nouveau, se trouve soulignée l’importance cruciale des relations bilatérales entre la Chine et les Etats-Unis : la première n’a aucune raison présente (si elle devait subir une nouvelle crise financière, il pourrait en aller autrement) d’accepter de céder aux demandes des seconds, si l’administration et le Congrès américains ne sont pas capables de s’inscrire dans une transition négociée de l’unilatéralisme au multilatéralisme, qui leur reconnaisse toute leur place actuelle et future.
De plus, face aux autres sortes de dumping (cf. infra), l’ajustement monétaire est évidemment le mode le plus indolore de sanction, propre à garantir l’ensemble du fair trade.
– Le dumping fiscal doit être combattu de la façon la plus inflexible qui soit : pas de commerce avec les trafiquants du moins disant fiscal et les poursuites pénales aussi bien que civiles doivent également toucher les donneurs d’ordre que les sous-traitants, en vertu du principe général de droit qui veut que le complice soit puni de la même peine que l’auteur principal d’un délit. A cet égard, la distinction entre évasion et fraude fiscale doit être abolie, pour les marchandises comme pour les capitaux ; la traçabilité de toutes les transactions doit être assurée, ce qui est par ailleurs indispensable pour des raisons sanitaires et écologiques : puisque la transparence est heureusement à la mode, incluons son principe dans les règles fondamentales d’une nouvelle organisation mondiale du commerce, placée sous l’égide des Nations Unies et soumise à sa charte.
– Le dumping social constitue sans doute le primum movens de la grande crise en cours : parce que les comportements d’affectation de leurs revenus sont d’une nature différente entre les bénéficiaires d’un revenu du capital et ceux qui vivent essentiellement de leur travail et jouent, par conséquent, un rôle essentiel dans l’évolution respective des dépenses d’investissement et de consommation. Parce que la masse des salaires n’avait cessé de baisser par rapport à la part des profits, les dépenses de consommation des ménages avaient de plus en de plus mal à absorber tous les flux de marchandises générées par une masse trop gigantesque d’investissement, même en partie gaspillés : tous les dépenses « bling bling » des plus riches finissaient par ne plus suffire ! La réponse à cette contrainte est connue depuis au moins un demi-siècle : c’est celle de la règle d’or, suivant laquelle les salaires doivent progresser au même rythme que l’augmentation des gains de productivité. Bien entendu, une telle règle ne s’impose pas spontanément : elle résulte nécessairement d’une négociation explicite ou implicite, centralisée ou décentralisée, avec ou sans l’état, voire même la société civile (les tentatives de quadripartisme en Irlande) : à cet égard, l’idée de transposer les règles d’un pays à l’autre est illusoire et même franchement contre-productive : pour ne donner qu’un exemple, face à la terrible réalité du travail des enfants, commençons plutôt par obtenir partout la mise en œuvre de la scolarité à mi-temps, plutôt que d’interdire toute importation en provenance des pays qui le pratiquent, au motif, parfois hypocrite, d’imposer nos propres normes : derrière le fair trade, veillons à ce que les pays qui se veulent les plus « blancs » ne cachent pas trop de noirs dessins. Or, dans la plupart des pays, le chantage à la mondialisation du patronat et des gouvernements qui lui sont favorables, ont conduit à l’adoption d’un comportement de « passagers clandestins ». C’est comme cela que nos sociétés ne sont pas seulement devenues de plus en plus injustes, mais en même de plus en plus inefficaces et/ou fragilisées par l’endettement, ce qui à la longue revenait au même.
C’est pourquoi les confédérations internationales de travailleurs (CIS, CES) et le BIT doivent obtenir la mise en place de règles de négociations internationales, qui fixeront la façon dont chaque pays fera évoluer la masse salariale globale suivant cette règle d’or, en fonction de sa situation conjoncturelle initiale, puis en fonction de ses propres préférences collectives (salaire et/ou temps de travail, salaire direct et/ou indirect, etc.) et, bien entendu, en suivant ses propres procédures de délibération.
– Le dumping écologique est par trop criant, sur la plus grande partie de la planète, pour nécessiter une longue explication. De plus, la question dépasse largement les enjeux du commerce loyal : même répartis équitablement, les droits à polluer s’additionnent, alors que tout l’enjeu est de les réduire, voire de les supprimer. C’est pourquoi, l’échec de la conférence de Copenhague a au moins démontré que les volets commerciaux et écologiques doivent être simultanément traités dans les grandes négociations internationales, ce qui fournit une justification supplémentaire au passage sous l’égide des Nations unies de l’OMC et de l’ensemble des autres organisations économiques et financières.
Une mise en œuvre rapide
La prolongation et donc l’approfondissement de la dépression créent une urgence inédite. Sans faire aucune concession aux fausses idées en vogue, il est du devoir de tous les citoyens responsables de proposer des solutions immédiatement applicables, ne serait-ce que parce qu’elles bénéficient déjà sur le plan militant ou, a fortiori sur le plan institutionnel d’une base importante de consensus :
– sur le plan militant, nous disposons de deux textes, qui, à la lumière de ce qui précède, se complètent largement : d’une part, il s’agit de « la Déclaration Syndicale de Londres » émanant de la Confédération internationale des Syndicats (CIS), publiée à l’occasion du G20 ; d’autre part, il s’agit du document de référence sur déclaration de Belem du Forum Social : « Pour un nouveau modèle économique et social. Mettons la finance à sa place ». On ne saurait trop inviter les uns et les autres à se rapprocher pour rédiger une plate-forme commune, sur la base de laquelle pourraient se réunir d’ici au début septembre toutes les démarches militantes, syndicales et « mouvementistes » : il s’agirait de démontrer à l’opinion mondiale et, par conséquent, aux principaux décideurs mondiaux qu’ils sont devant une alternative claire : ou bien, continuer à ruser avec l’histoire, quitte à sacrifier de façon plus symbolique que réelle quelques-uns de leurs anciens fétiches, mais au risque de provoquer les pires errements incontrôlables dans des délais qui pourraient être très courts ; ou, bien assumer dans toutes ses dimensions une mondialisation d’un type nouveau, afin de réellement « tourner la page des années dominées par la cupidité», comme ils prétendent vouloir le faire. De la qualité de cette convergence entre forces syndicales et mouvementistes, dépend à l’évidence la seconde convergence qui, des textes et des mobilisations, devrait se traduire dans la réalité des décisions.
– Sur le plan institutionnel, il existe en effet également deux autres textes de référence qui, avec les précédents, peuvent jouer un rôle crucial dès le mois de septembre : d’abord celui de l’Organisation Internationale du Travail, avec sa proposition phare d’un « plan mondial pour l’emploi » ; ensuite, celui de la commission Stiglitz, commandé par le président de l’Assemblée Générale des Nations Unies, sur la réforme du système monétaire et financier international. Avec les textes précédents et les mobilisations qu’ils peuvent susciter, il y a matière à placer d’abord l’ensemble des états du monde réunis formellement en Assemblée générale, devant la nécessité de trancher entre les voies ouvertes
Cet article a été publié le 4 novembre sur le blog « alterAutogestion » de notre camarade Richard NEUVILLE
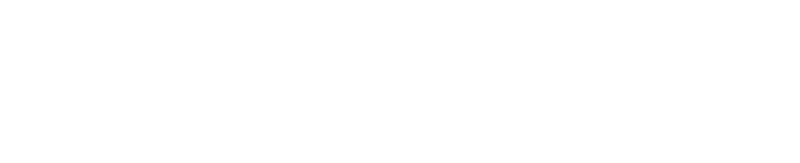
Soyez le premier à poster un commentaire.