Publié le
dimanche, 15 janvier 2017 dans
A Gauche. . . toute !, TRAVAIL Au printemps 2015, en pleine lutte contre la loi-travail, nous avons posé à Charles PIAGET, figure emblématique de la lutte des LIP en 1973, quelques questions à propos du travail. . . Ce qu’il nous a dit entre en résonance avec la problématique mise en avant dans la lutte
 Quelle a été ta première approche du travail ?
Quelle a été ta première approche du travail ?
Charles PIAGET : Lorsque je suis sorti de l’école (trois ans d’enseignement en mécanique), j’avais le sentiment d’être formé théoriquement mais pas pratiquement. Je me rendais compte à quel point nous étions déficients, par exemple par rapport aux machines..
Je ne connaissais pas le monde de l’entreprise. Et l’entreprise, on ne la visitait pas. Quelqu’un vous amenait à votre poste et vous n’aviez pas le droit d’en bouger, d’aller voir à côté comment ça se passait. . .Ce pouvait causer votre licenciement. Tout était cloisonné. C’est dans ce contexte que j’ai découvert mon métier de mécanicien-outilleur : fabriquer l’outillage nécessaire à la fabrication des montres.
Nous étions une dizaine de jeunes, sortant de lycées professionnels, fraichement embauchés et là, première surprise, nous nous sommes rendu compte que les anciens refusaient de nous montrer quoi que ce soit, de nous donner le moindre conseil. La concurrence. . . Ils nous considéraient comme de « futurs concurrents » qui risquaient de « leur piquer leur place ». Ils avaient de bons salaires. Au sortir de la guerre, il y avait besoin de professionnels qualifiés. .
Il n’y avait pas le nombre de machines nécessaires pour chaque ouvrier et  nous étions dans la nécessité de discuter entre nous pour leur utilisation, ce qui permettait une certaine liberté
nous étions dans la nécessité de discuter entre nous pour leur utilisation, ce qui permettait une certaine liberté
Quelques années plus tard, devenu délégué du personnel, j’ai eu le droit de circuler dans les divers ateliers et j’ai pu découvrir des réalités différentes de celle de mon atelier.
En particulier, j’ai vu des femmes, répétant 5000, 6000, et même jusqu’à 10000 fois le même geste. Elles étaient debout. Il n’y avait pas de siège.
Autre chose qui m’avait sidéré : en horlogerie, avec des professionnels qualifiés, il n’y avait pas le moindre bruit, pas la moindre parole. Tout le monde était courbé sur son poste. Et il y avait même un sbire, sur une estrade, qui veillait à ce que personne ne bouge, à ce qu’il n’y ait pas d’échanges.
Je me suis rendu compte de l’erreur où j’étais en pensant que c’était partout comme dans mon atelier. Chez nous, il y avait déjà la concurrence, un manque de fraternité. . . Les conditions de travail étaient terribles.
A cette époque là, pour toi, le travail c’était quoi ?
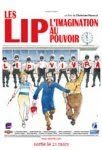 Je ne me posais même pas ce genre de question. Il fallait travailler pour ramener de l’argent à la maison. J’étais privilégié en quelque sorte : les autres commençaient à 14 ans, moi 3 années plus tard avec ma formation. . Avec la cible que j’avais en tête, j’étais bien loin du syndicalisme ! Je souhaitais devenir « un bon professionnel ». Ce travail m’intéressait et ramener davantage d’argent à la maison me motivait. C’était une période où nous travaillions 48h par semaine pour un salaire 25% inférieur à celui d’avant guerre. La nourriture était, de loin, la principale dépense.
Je ne me posais même pas ce genre de question. Il fallait travailler pour ramener de l’argent à la maison. J’étais privilégié en quelque sorte : les autres commençaient à 14 ans, moi 3 années plus tard avec ma formation. . Avec la cible que j’avais en tête, j’étais bien loin du syndicalisme ! Je souhaitais devenir « un bon professionnel ». Ce travail m’intéressait et ramener davantage d’argent à la maison me motivait. C’était une période où nous travaillions 48h par semaine pour un salaire 25% inférieur à celui d’avant guerre. La nourriture était, de loin, la principale dépense.
Je m’étais retrouvé dans l’apprentissage mécanique, mais j’aurais pu être tout aussi bien dans l’apprentissage bois. . . Petit à petit j’ai découvert et aimé ce métier.
Dans mes premiers temps de travail, lorsque, au sein du groupe de jeunes embauchés en même temps que moi, nous avons compris que nous n’aurions aucune aide de nos collègues, l’un de nous a eu une idée formidable. Il nous a proposé de noter sur un carnet les problèmes rencontrés et comment on les avait surmontés – ou pas . . .-. « On devrait avancer 10 fois plus vite que d’être seuls ! « , nous avait-il dit. Et nous avons avancé, en effet. Je découvrais ce que plus tard, j’ai appelé « la force du collectif ». Voilà qui nous a été précieux, qui nous a permis d’avancer (voir comment l’autre s’en sortait !).
Je ne me posais pas de questions, alors. Elles sont venues plus tard, avec le  syndicalisme. Là, ça nous a obligé à nous poser des questions. . . Par exemple, le travail tellement décortiqué. . . Le chargement des pièces sur les machines. . . Celui-ci n’était pas encore automatisé. Une pièce chargée toutes les 3 secondes. .. 8000 fois le même geste dans la journée. Parfois, le régleur avait l’ordre d’aller plus vite. . . 2, 8 secondes
syndicalisme. Là, ça nous a obligé à nous poser des questions. . . Par exemple, le travail tellement décortiqué. . . Le chargement des pièces sur les machines. . . Celui-ci n’était pas encore automatisé. Une pièce chargée toutes les 3 secondes. .. 8000 fois le même geste dans la journée. Parfois, le régleur avait l’ordre d’aller plus vite. . . 2, 8 secondes
Cela nous posait des questions ; c’était une « dénaturation », une « amputation » de l’être humain. On avait sans doute repéré dans une lecture le mot « amputation ». Ce mot prenait tout son sens concrètement pour nous, à travers ces réalités là. L’être humain, c’est dans sa nature d’être « producteur », d’aller jusqu’au bout de son travail. Celui qui travaillait dans un atelier de « professionnels » dans un horizon tout petit, mais bien moins que l’OS qui avait un horizon extrêmement petit. .
Vous croyez que c’est possible, une chose pareille ?
Tu poses la question des conditions de travail et surtout de la dépossession.
 On va prendre un petit exemple, en 68, au moment de la bagarre. L’idée, dans la CFDT – et aussi ailleurs -, c’était la « recomposition des tâches ». On ne pouvait pas laisser aller « le taylorisme » à des degrés fous, comme c’était parti. II fallait obliger l’employeur à recomposer les tâches.
On va prendre un petit exemple, en 68, au moment de la bagarre. L’idée, dans la CFDT – et aussi ailleurs -, c’était la « recomposition des tâches ». On ne pouvait pas laisser aller « le taylorisme » à des degrés fous, comme c’était parti. II fallait obliger l’employeur à recomposer les tâches.
Nous sommes allé voir des ouvrières sur une chaine de montage, pour leur poser la question du « quoi » et du « comment » ce pourrait se faire sur leur chaine. Quelques jours après, l’une d’elles est venue nous voir, au nom des autres. « Voilà, nous avons discuté avec les collègues. Sur la chaine, on monte une aiguille sur les 3. Est-ce qu’on pourrait arriver à en monter deux ? ».
Nous étions complètement renversés par cette demande. Abasourdis, nous lui avons dit : « Mais, ce n’est pas deux aiguilles qu’il vous faut monter, mais tout le cadran, une partie de la montre. . . « . Ce fut son tour d’être interloquée : « Vous croyez que c’est possible de faire une chose pareille ? « . Ce qui montre à quel point le cerveau est modifié pour arriver à croire que « Deux aiguilles, ce serait formidable. . . « en termes d’intérêt du travail. Cela montre à quel point on peut être complètement déformés par le boulot. . .
« Je me suis réveillée ! «
J’ai parlé tout à l’heure de « dépossession ». Mais, à travers ce que tu racontes, c’est le mot « aliénation » qui vient à l’esprit : Ce qui est terrible, c’est que des personnes en arrivent à imaginer qu’elles n’ont pas les capacités pour aller plus loin. . .
Tout à fait. . . C’était impensable. Et nous nous sommes dit que nous étions tous dans la même barque, tous « déformés ». On n’a pas la connaissance du produit, mais d’une toute petite partie
On a vu des choses extraordinaires autour de cette idée d’amputation, d’aliénation.
Un autre exemple ? En 73 durant notre lutte, des horlogers viennent nous voir, affolés. Plus possible de produire une catégorie de montres qui partent bien. . . Or tout un tas de bracelets peuvent convenir au cadran . . . Mais, monter un autre bracelet que celui prévu sur ce cadran ? Impensable. . . Leur cerveau était comme ligoté, comme s’il y avait interdiction d’imaginer autre chose ou de se dire que l’on pouvait faire autre chose, utiliser d’autres capacités que nous avions . . . peut être sans le savoir.
Et nous nous sommes dit que nous étions tous tellement déformés que nous  ne voyons pas nos propres déformations et que si des horlogers venaient en mécanique,, sans doute nous feraient-ils toucher du doigt des comportements similaires.
ne voyons pas nos propres déformations et que si des horlogers venaient en mécanique,, sans doute nous feraient-ils toucher du doigt des comportements similaires.
En 68, on a commencé à se douter à quel point nous étions formaté.e.s.
Quel type de citoyens sommes-nous si nous n’avons rien d’autre que le boulot. Il faut s’intéresser à bien d’autres choses, à la vie sociale, à la vie politique. Nous nous sommes rendu compte à quel point c’est criminel de dire à quelqu’un « Tu n’utilises qu’une infime partie de ton cerveau ». . .Le taylorisme c’était ça !
Tu poses cette prise de conscience, pour toi comme pour les syndicalistes de ton syndicat, autour de mai 68. . . C’est ce mouvement qui a été déclencheur ?
Tout à fait. Avant, nous avions déjà perçu certains signes, mais pas bouleversants comme là. Ce n’a duré que deux semaines, mais deux semaines, courtes et formidables, de désaliénation du travail et çà a été énorme !
 Une illustration, parmi bien d’autres ? J’étais, à l’époque, responsable des ébauches; une de nos collègues devait faire 13000 pièces chaque jour. . Elle exigeait d’avoir, dès le départ, tout le matériel nécessaire auprès d’elle. Elle houspillait le régleur qui ne lui en mettait que 10 000. . .Tout son être, tout son cerveau était consacré, était concentré sur la tâche.
Une illustration, parmi bien d’autres ? J’étais, à l’époque, responsable des ébauches; une de nos collègues devait faire 13000 pièces chaque jour. . Elle exigeait d’avoir, dès le départ, tout le matériel nécessaire auprès d’elle. Elle houspillait le régleur qui ne lui en mettait que 10 000. . .Tout son être, tout son cerveau était consacré, était concentré sur la tâche.
Nous avons eu avec elle, après ces deux semaines, des discussions passionnantes. « Je me suis réveillée. . . J’étais comme folle !« , nous disait-elle. « Je vais me détacher du boulot à présent ! »
Parce qu’on a arrêté l’aliénation durant ces 2 semaines, il y a eu des conversions. . .
Ce qui voudrait dire que les personnes qui travaillaient côte à côte tout au long de l’année ont commencé à « se parler ?
Tout à fait. On a commencé à se faire visiter nos différents secteurs de travail : horlogerie, mécanique. . . , puis les bureaux. Nous avons fraternisé. Depuis des années, nous essayions de construire des revendications unifiantes. En 2 semaines nous avons avancé autant qu’en 3 années !
La hiérarchie, c’est quelque chose qu’on doit réfléchir
Il y a eu des avancées, des abandons aussi. . . Et dans cette période jusque vers 1973 des personnes, dont ton syndicat, ont mis en avant le mot d’ordre de « contrôle ouvrier ». Entre 1968 et 1972, aussi bien dans le parti politique que dans le syndicat auxquels tu appartenais alors (NDLR : le PSU et la CFDT), on a commencé à mettre en avant le mot d’ordre de « contrôle ouvrier ». . .
Oui, tout à fait. . . On n’a pas pu aller très loin, mais certaines des  revendications posées ont été satisfaites, telles « le salaire aux pièces ». L’essentiel était d’essayer de se dégager de cette « rigueur tayloriste » qui nous étouffait.
revendications posées ont été satisfaites, telles « le salaire aux pièces ». L’essentiel était d’essayer de se dégager de cette « rigueur tayloriste » qui nous étouffait.
On a essayé d’avancer un peu, surtout dans la compréhension. Avant 68, j’ai connu une fronde de la part des « professionnels ». Au syndicat, nous étions alors pleinement conscients de l’importance des OS qui supportaient tout le poids : 70% des employé.e.s étaient des OS et en particulier les femmes. Ce sont elles qui faisaient l’essentiel du boulot, sur les machines.
Un jour au retour de réunion, je me suis retrouvé entouré par un groupe de « professionnels » me reprochant de « Ne mettre en avant que les OS. .. A quoi sert-il que nous ayons des formations? » Je leur ai répondu : « Il y a une marge me semble-t-il entre vos salaires et les leurs! Vous rendez-vous compte que, sans leur travail, votre « outillage » est impossible? ».
Nous avons montré que nous étions tributaires les uns des autres, que pour fabriquer un produit on était tous nécessaires. Que nous, les OP, avions un travail intéressant et des salaires élevés et que les OS accomplissaient des tâches inintéressantes avec des salaires faibles.
Ce ne fut pas simple, mais nous avons avancé quelque peu, Ça a réagi durement, mais des choses ont commencé à avancer. Par exemple que c’est, en fin de compte, le patron qui décide que l’OP doit être plus payé que l’OS, ce qui est fort discutable. Un certain nombre d’idées, de représentations complètement folles sont bien ancrées en nous. C’est une des forces du système, qui permet de « gouverner » une entreprise, en nous divisant pour être plus fort.
 68 avait été un choc. Que dire de 73? Au début, lorsqu’un technicien prenait la parole en AG, il était écouté avec son « aura » de technicien (parfois même, d’ »agent de maitrise »! !). Petit à petit, l’AG a pu voir qu’un OS, une femme OS ou un OPA exprimaient des idées, des propositions profondément humaines. . . Ce n’était plus la technique qui était aux commandes, mais l’humain.
68 avait été un choc. Que dire de 73? Au début, lorsqu’un technicien prenait la parole en AG, il était écouté avec son « aura » de technicien (parfois même, d’ »agent de maitrise »! !). Petit à petit, l’AG a pu voir qu’un OS, une femme OS ou un OPA exprimaient des idées, des propositions profondément humaines. . . Ce n’était plus la technique qui était aux commandes, mais l’humain.
Durant ces années 70, il y a eu des mouvements d’OS, surtout dans l’automobile et en particulier chez Renault. Tu décris chez LIP, une population OS féminine. Chez Renault il s’agissait d’immigrés. . .
Des populations considérées comme « en dessous ». . . Chez LIP, une seule  femme dans le 3ème collège, très peu d’ouvrières professionnelles en horlogerie. La grande masse était OS, sans qualification, sans perspectives. . . C’est vrai ce que tu rappelles. . . Un mouvement qui a montré aux « professionnels » qu’il y avait une catégorie qui souffrait plus qu’eux. Tout le monde souffre du capitalisme, mais cette catégorie était encore plus déconsidérée alors qu’elle faisait tourner la boutique du capitalisme.
femme dans le 3ème collège, très peu d’ouvrières professionnelles en horlogerie. La grande masse était OS, sans qualification, sans perspectives. . . C’est vrai ce que tu rappelles. . . Un mouvement qui a montré aux « professionnels » qu’il y avait une catégorie qui souffrait plus qu’eux. Tout le monde souffre du capitalisme, mais cette catégorie était encore plus déconsidérée alors qu’elle faisait tourner la boutique du capitalisme.
Nous, on était contre cette division du travail, contre ces écarts dans les salaires, les responsabilités. On disait que « La hiérarchie, c’est quelque chose qu’on doit réfléchir et qui doit s’amenuiser au fil du temps, lorsque chaque personne comprendra que nous sommes interdépendants ». On n’a pas besoin d’avoir des écarts comme çà !
Nous arrêtons là la transcription de cet entretien avec Charles PIAGET.
 Cet entretien téléphonique a été publié dans quatre numéros de « Noir, Rouge, Vert, Violet ». Il a été réalisé par notre camarade Jean FAUCHE, le 1er avril 2016 à 10h 30
Cet entretien téléphonique a été publié dans quatre numéros de « Noir, Rouge, Vert, Violet ». Il a été réalisé par notre camarade Jean FAUCHE, le 1er avril 2016 à 10h 30
Nous espérons mener prochainement avec lui une série d’entretiens, autour de la question de l’Autogestion.
 Quelle a été ta première approche du travail ?
Quelle a été ta première approche du travail ? 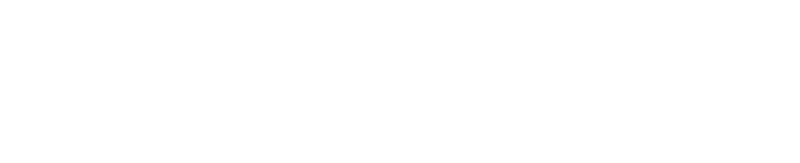

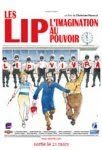







Soyez le premier à poster un commentaire.