Publié le
mercredi, 13 avril 2016 dans
TRAVAIL  On a surtout critiqué le projet El Khomri pour ses effets sur les conditions de travail et les rémunérations. C’est sous l’angle du détricotage des 35 heures et de la dégradation de la condition salariale qu’on a dénoncé l’inversion de la hiérarchie des normes sociales. Mais on a moins prêté attention à l’ensemble des procédures qui rendent ces remises en cause possibles et encore moins au type de syndicalisme que ces règles présupposent. Or, c’est littéralement un changement de nature du syndicalisme que précipiterait l’adoption de cette réforme.
On a surtout critiqué le projet El Khomri pour ses effets sur les conditions de travail et les rémunérations. C’est sous l’angle du détricotage des 35 heures et de la dégradation de la condition salariale qu’on a dénoncé l’inversion de la hiérarchie des normes sociales. Mais on a moins prêté attention à l’ensemble des procédures qui rendent ces remises en cause possibles et encore moins au type de syndicalisme que ces règles présupposent. Or, c’est littéralement un changement de nature du syndicalisme que précipiterait l’adoption de cette réforme.
Myriam El Khomri l’a dit dans son premier discours présentant officiellement son projet de réforme du Code du travail, en février 2016 : « le gouvernement cherche à renforcer les syndicats en leur donnant plus de moyens, en améliorant leur formation, en valorisant l’engagement. » Depuis que Nicolas Sarkozy a osé intituler une tribune dans Le Monde « Pour des syndicats forts », on peut se permettre de douter de la validité de telles déclarations d’intention. Elles contiennent pourtant une part de vérité. Les réformes engagées depuis plusieurs années dans le domaine des relations de travail entendent bien, d’une certaine manière, renforcer les syndicats… à la condition que ceux-ci acceptent de devenir des auxiliaires de la gestion néolibérale des entreprises.
Mettre les syndicats au service du « dialogue social » plutôt que des salariés:
Dans le projet de réforme du Code du travail, les syndicats ne sont reconnus que dans la mesure où ils concourent au « dialogue social ». Les seuls moyens nouveaux qui leur sont donnés portent sur les mandats de négociation : délégués syndicaux, délégués syndicaux centraux et salariés participant à la négociation, dont les crédits d’heures seraient augmentés de 20 %. Il s’agit du maigre  lot de consolation accordé en échange de l’importance nouvelle donnée à la négociation d’entreprise. Rien pour les délégués des syndicats non représentatifs (RSS), qui ne participent pas à la négociation. Pas question d’attribuer à tous les salariés un droit à l’information syndicale, comme il existe dans la fonction publique, qui permettrait aux représentants syndicaux de les associer plus étroitement au mandat syndical.
lot de consolation accordé en échange de l’importance nouvelle donnée à la négociation d’entreprise. Rien pour les délégués des syndicats non représentatifs (RSS), qui ne participent pas à la négociation. Pas question d’attribuer à tous les salariés un droit à l’information syndicale, comme il existe dans la fonction publique, qui permettrait aux représentants syndicaux de les associer plus étroitement au mandat syndical.
Seuls comptent les syndicats qui participent aux négociations. C’est littéralement ce que confirme la nouvelle formule de calcul des accords d’entreprise. Depuis 2008, pour qu’un accord soit valide, il doit être signé par des syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles. Le projet relève à 50 % le seuil de validation des accords, mais en modifiant le décompte qui est désormais basé sur les suffrages recueillis par les seules organisations représentatives[1]. En d’autres termes, les voix des salariés qui se sont portées sur des organisations ayant obtenu moins de 10 % des suffrages sont maintenant totalement ignorées.
Si en plus de négocier, les syndicats ont la signature facile, ils auront droit à un bonus supplémentaire. Dans les cas où ils seraient minoritaires parmi les organisations représentatives, une consultation leur permettra d’enrôler les salariés pour légitimer leurs arrangements avec l’employeur. C’est dans ce cadre qu’il faut situer le recours au référendum d’entreprise et non dans une soi-disant promotion de la « démocratie participative » agitée par la ministre[2]. Comme on l’a déjà rappelé sur ce site ici et là, la parole des salariés n’est sollicitée que pour faire sauter le verrou d’une opposition syndicale. La négociation du protocole organisant la consultation exclut d’ailleurs les syndicats opposés à l’accord, laissant aux seuls syndicats signataires le soin, avec le patron, de créer les conditions les plus propices à la réussite du referendum.
Faire de la négociation collective un instrument de la gestion néolibérale
 Le texte crée la possibilité d’une « formation des acteurs de la négociation collective », commune aux syndicalistes et aux employeurs. Cette disposition n’a pas suscité grande attention. Outre le fait qu’elle siphonnerait le budget de la formation syndicale, elle rompt pourtant avec un principe essentiel, celui de l’autonomie des organisations syndicales dans la conduite de leurs formations.
Le texte crée la possibilité d’une « formation des acteurs de la négociation collective », commune aux syndicalistes et aux employeurs. Cette disposition n’a pas suscité grande attention. Outre le fait qu’elle siphonnerait le budget de la formation syndicale, elle rompt pourtant avec un principe essentiel, celui de l’autonomie des organisations syndicales dans la conduite de leurs formations.
Depuis la reconnaissance du droit à l’éducation ouvrière dans les années 1950, la formation syndicale des salariés est assurée par les confédérations, soit directement par leurs organismes dédiés, soit indirectement via les instituts du travail où les syndicats sont représentés. C’est ce qui permet à la formation, quand les syndicats le décident, d’être le véhicule d’une certaine conscience de classe et de sensibiliser les militants à aborder les dossiers de manière politique, sans s’en tenir à la définition patronale ou technocratique des problèmes. Cette autonomie de pensée est essentielle, par exemple pour définir des stratégies de négociation, coordonner l’action des élus du personnel ou ne pas rester prisonnier d’approches individualisantes de la « souffrance au travail ».
Cette proposition de formation commune au « dialogue social » avait été formulée dans le rapport Combrexelle, remis au Premier ministre en septembre 2015. Il vaut la peine de s’attarder un peu sur la prose de celui qui fut à la tête de l’administration du travail pendant treize ans, car ses idées inspirent largement le projet El Khomri. L’ancien Directeur général du travail avance comme proposition n°1 de son rapport d’« élaborer une pédagogie de la négociation collective démontrant le caractère rationnel et nécessaire de celle-ci dans un contexte concurrentiel et de crise économique »[3]. Mais tous les syndicalistes ont toujours su négocier et passer des compromis. Ses préconisations visent en réalité autre chose, une véritable « révolution culturelle » comme il l’écrit : « La question de fond est posée aux organisations syndicales : considèrent-elles que, par nature, la négociation collective est un instrument distributif d’augmentation des salaires, de réduction du temps de travail, d’amélioration des conditions de travail ? ou admettent-elles qu’elle peut être aussi un instrument adapté dans un contexte de crise économique et sociale ? »[4]
Il s’agit de parachever l’évolution de la négociation comme un outil de gestion et de « performance » économique. C’est pourquoi la valorisation du dialogue social va de pair avec la promotion de la négociation d’entreprise. L’objectif est d’amener les syndicats à accepter que la négociation ne soit plus « un outil essentiellement tourné vers la distribution du surplus », mais un moyen d’accompagner la stratégie des entreprises[5]. L’enjeu est, derrière un éloge de la négociation en général, de conduire les syndicats à accepter la négociation de concession. C’est à cela et à rien d’autre que sert le dynamitage du principe de faveur, tout comme l’extension des anciens « accords de maintien dans l’emploi ».
Un changement de régime syndical
Le projet El Khomri s’inscrit dans la continuité d’un ensemble de réformes qui tendent à subordonner le syndicalisme à la logique d’entreprise. La loi d’août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » a constitué une étape majeure dans ce processus, avec la décision de faire dépendre la représentativité syndicale des élections aux comités d’entreprise. On a pointé ailleurs les ambiguïtés qui ont rendu possible cette réforme : alors que certains y voyaient un moyen de revitaliser l’action syndicale, elle a surtout contribué à conforter la négociation d’entreprise en lui apportant le gage démocratique du vote des salariés. Le projet El Khomri parachève ce mouvement en systématisant la neutralisation du principe de faveur : c’est bien désormais dans les entreprises que se décideront les règles décisives. Il nous rapproche des modèles de relations professionnelles à l’anglo-saxonne, où l’essentiel des garanties collectives se négocie à ce niveau. Imitant un peu plus ce modèle anglo-saxon, il prévoit en outre que les accords d’entreprise aient désormais une durée limitée de cinq ans. Périodiquement, les garanties collectives cesseraient de s’appliquer, forçant les syndicats à devoir tout renégocier.
C’est un véritable changement de régime qui est en jeu. Certains syndicalistes y voient un grandissement de leur mission. Le rôle qu’ils seraient appelés à jouer est beaucoup plus important, c’est incontestable. Mais il sera aussi très différent. La négociation collective, dans sa logique de pérennisation des acquis et d’empilement au plus favorable des garanties collectives, visait à réduire les incertitudes du marché capitaliste pour les salariés, voire même à le dépasser. Dans ce nouveau régime rythmé par la négociation d’entreprise à durée déterminée, il s’agira de contraindre les syndicalistes et, par leur intermédiaire, tous les salariés, à intérioriser comme une donnée indépassable les incertitudes du marché, la possibilité toujours ouverte de nouvelles concessions.
A contrario, les décisions de gestion de l’employeur, tels les licenciements, seront mieux protégées.
Ainsi les incertitudes ne seront-elles pas aussi fortes pour tout le monde. Le texte ne s’intitule-t-il pas « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs » ? Là encore, il faut trouver la part de vérité dans la géniale ambiguïté de cette formule où libertés et protections semblent indistinctement promises aux entreprises et aux actifs, tandis que patrons et salariés ont disparu. Si le texte est adopté, peut-être verra-t-on dans la foulée surgir, comme une « protection » supplémentaire, des « clauses de paix sociale » interdisant tout recours à la grève pendant la durée de validité du contrat collectif ? Ces dispositions avaient été généralisées dans les entreprises étatsuniennes au cours de la Seconde guerre mondiale. En ces temps de mobilisation générale pour la « compétitivité », on voit bien des « réformistes » se rallier au patriotisme économique et confondre les intérêts des salariés avec ceux de leurs patrons. Il ne leur resterait qu’un petit pas de plus à franchir pour défendre de telles propositions.
[1] Cette règle était déjà en vigueur pour les accords de branche et les accords nationaux interprofessionnels.
[2] Discours devant la commission nationale de la négociation collective déjà cité.
[3] Jean-Denis Combrexelle, La négociation collective, le travail et l’emploi, Rapport au Premier ministre, septembre 2015, p. 51.
[4] Ibid., p. 39.
[5] Ibid., p. 51.
 On a surtout critiqué le projet El Khomri pour ses effets sur les conditions de travail et les rémunérations. C’est sous l’angle du détricotage des 35 heures et de la dégradation de la condition salariale qu’on a dénoncé l’inversion de la hiérarchie des normes sociales. Mais on a moins prêté attention à l’ensemble des procédures qui rendent ces remises en cause possibles et encore moins au type de syndicalisme que ces règles présupposent. Or, c’est littéralement un changement de nature du syndicalisme que précipiterait l’adoption de cette réforme.
On a surtout critiqué le projet El Khomri pour ses effets sur les conditions de travail et les rémunérations. C’est sous l’angle du détricotage des 35 heures et de la dégradation de la condition salariale qu’on a dénoncé l’inversion de la hiérarchie des normes sociales. Mais on a moins prêté attention à l’ensemble des procédures qui rendent ces remises en cause possibles et encore moins au type de syndicalisme que ces règles présupposent. Or, c’est littéralement un changement de nature du syndicalisme que précipiterait l’adoption de cette réforme.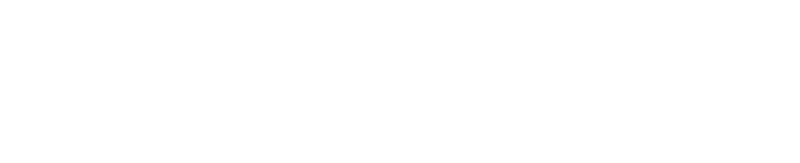


Soyez le premier à poster un commentaire.