Publié le
mardi, 29 septembre 2015 dans
Non classé, Point de vue, TRAVAIL
 Après les lois Macron et Rebsamen, le rapport Combrexelle menace le Code du travail d’une réforme profonde qui donnerait plus de poids aux accords d’entreprise au détriment de la loi. Philippe Légé décrypte les attaques contre le droit du travail.
Après les lois Macron et Rebsamen, le rapport Combrexelle menace le Code du travail d’une réforme profonde qui donnerait plus de poids aux accords d’entreprise au détriment de la loi. Philippe Légé décrypte les attaques contre le droit du travail.
C’est un gouvernement de combat qui entame la dernière ligne droite du quinquennat. Le Code du travail est au centre de sa politique de réformes. Entre l’accord national interprofessionnel de 2013 (ANI), puis les lois Macron et Rebsamen, les trois premières années avaient donné le ton. En cette rentrée sociale et tout au long de l’année 2016, les nouveaux chantiers ne vont pas manquer. Ils mettront la majorité à l’épreuve de ses frondeurs, tant les orientations libérales assumées par Manuel Valls et Emmanuel Macron ont vocation à diviser la gauche.
La prochaine conférence sociale se tiendra les 19 et 20 octobre. Les syndicats s’attendent à un coup pour rien, tant la suite semble écrite à l’avance. Sous couvert de « simplification » du Code du travail, le rapport Combrexelle préconise sa refondation pure et simple. Objectif ? Le réduire à des règles essentielles, renvoyer le reste à la négociation dans les branches et dans les entreprises. Pour un droit du travail à la carte ? Certains évoquent un Smic de branche, voire une durée du travail qui ne serait plus légale, mais négociée.
Un premier projet de loi est attendu pour début 2016, la réécriture du Code devant intervenir d’ici quatre ans. À surveiller aussi dans les mois qui viennent : la renégociation des retraites complémentaires, puis celle de l’assurance-chômage. Pour décrypter cette rafale de réformes, Regards s’est entretenu avec Philippe Légé, maître de conférence en économie à l’université de Picardie, membre de l’Association française d’économie politique (AFEP), et du collectif des Économistes atterrés.
* * *
Regards : Comment jugez-vous la succession de réformes menées par le gouvernement sur le marché du travail ?
Philippe Légé. Contrairement à ce que l’on entend souvent, ces trente dernières années la France a énormément réformé son marché du travail, et cela toujours dans le sens d’une libéralisation accrue.
Depuis le début du quinquennat, il y a eu l’accord national interprofessionnel de 2013, ainsi que sa transcription législative, la mal nommée « loi de sécurisation de l’emploi ». Puis les lois Macron et Rebsamen, qui ont encore accentué la tendance. Or la quasi-totalité des études évaluant ce type de politiques montre que leurs résultats sont nuls en termes de création d’emploi et de croissance. Par contre, elles ont aggravé la précarité, affaibli les droits sociaux.
Pourquoi les gouvernements successifs reconduisent-ils une politique qui n’atteint pas ses objectifs ?
Il y a plusieurs raisons à cela. En premier lieu, il faut noter un renversement total des causes et des conséquences dans le discours diffusé par les médias dominants. C’est en effet la multiplication des réformes libérales depuis trente ans, et notamment des possibilités de dérogation aux règles du Code du travail, qui ont alimenté sa complexité. Maintenant, on nous explique que le droit du travail est trop complexe, qu’il faut mettre en œuvre de nouvelles réformes pour étendre le champ des règles ouvertes à la négociation et à la dérogation !
Ensuite, sur le fond, ces orientations ont une dimension idéologique profonde qui, il faut le noter, converge avec les revendications du Medef. Déjà, à la fin des années 90, le discours patronal sur la « refondation sociale » appelait à une quasi-disparition du Code du travail au profit de la négociation et du contrat. La volonté de réduire la place de la loi est une constante au Medef. C’est un discours ancien, qui remonte à la fin du XIXe siècle. Ce qui a changé, c’est que le pouvoir politique est désormais très perméable à ces demandes. Il les a intériorisées, et va maintenant jusqu’à les anticiper dans ses réformes.
Le manque de pluralisme du débat économique ne joue-t-il pas un rôle dans cette hégémonie des politiques libérales ?
Les économistes ont effectivement une part de responsabilité dans cette situation. Ils apportent une justification pseudo-scientifique à ces choix politiques. Certains de mes collègues sont pourtant sincères : ils pensent que les dérégulations vont réduire le chômage, alors même que les études empiriques disent le contraire. L’une des explications tient aux postulats de la théorie qui domine la discipline, qu’on appelle théorie standard ou orthodoxe. Celle-ci considère les phénomènes économiques comme le résultat de choix volontaires effectués sur des marchés.
Sur le marché du travail, cela donne une vision qui fait totalement abstraction des rapports de pouvoir. L’un des économistes orthodoxes les plus influents, Paul Samuelson, écrivait la chose suivante en 1957 : « Souvenons-nous que dans un marché parfaitement concurrentiel, savoir qui embauche qui n’a aucune importance ; alors disons que le travail embauche le capital ». Or, la justification essentielle du droit du travail est l’existence d’un rapport de subordination, d’une inégalité de fait entre employeur et employé. Pris dans ce rapport hiérarchique, le salarié est en position très inconfortable pour négocier.
Cette négation des rapports de pouvoir serait donc un principe structurant des actuelles réformes du marché du travail ?
Effectivement. Une fois qu’on a évacué cette dimension essentielle, il n’y a plus qu’à tirer le fil. Cette vision erronée vient alimenter et justifier les réformes de libéralisation du marché du travail. Il s’agit d’une logique sous-jacente, que l’on repère systématiquement. On la retrouve dans le rapport de l’Institut Montaigne, par ailleurs lié au Medef, mais aussi dans celui de Gilbert Cette et Jacques Barthélémy, réalisé pour Terra Nova, qui s’intitule « Réformer le droit du travail ». Pour eux, le droit réglementaire doit être, je cite, « supplétif du droit conventionnel ».
Comment un gouvernement socialiste peut-il en arriver à une mise en cause aussi profonde des protections du salariat ?
Si l’on compare l’attitude des dirigeants socialistes aujourd’hui avec celle qu’ils adoptaient au milieu des années 80, on voit un retournement total. Les premières dérogations au Code sont apparues en 1982, avec les lois Auroux. Mais elles restent alors limitées et contrôlées. Il s’agit de concessions accordées au patronat en échange d’une réforme qui favorise la création de sections syndicales en entreprise, institue les CHSCT, améliore l’expression des salariés. On voulait progresser dans le sens d’une démocratisation des relations de travail. Ce qu’on observe aujourd’hui, c’est un mouvement et une logique rigoureusement inverses.
Par ailleurs, ce que l’on constate dans les domaines ouverts à la négociation d’entreprise, c’est une volonté assez nette de remettre en cause le monopole syndical. On met en avant le référendum en entreprise, c’est à dire une consultation directe des salariés, ainsi que le rôle des élus du personnel. Si l’on voulait court-circuiter les syndicats, on ne s’y prendrait pas autrement. Il y a pourtant déjà peu de délégués syndicaux dans les entreprises. On en conclut qu’il faut ouvrir davantage de possibilités de dérogations, pour qu’il y ait plus de négociation ! Il faudrait au contraire favoriser le renforcement de la présence syndicale dans les entreprises.
À l’échelle européenne, on constate une certaine similitude dans les réformes menées par les différents États. La Commission joue-t-elle un rôle central dans ce processus ?
Dans ce domaine, les décisions européennes contraignantes sont rares. Mais dans les faits, la Commission formule des recommandations, qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus appuyées depuis la crise de 2008, avec de très fortes pressions exercées sur des pays comme l’Espagne ou la Grèce. La Commission se réfère également à la Stratégie européenne pour l’emploi, qui préconise d’utiliser les fonds à travers des politiques « d’activation des chômeurs ». Au lieu d’indemniser, il s’agit d’inciter les chômeurs à reprendre un emploi. Encore faut-il que ces emplois existent !
Puisque ces politiques échouent à réduire le chômage, selon vous, quel type de politique faudrait-il mener ?
La question la plus importante, celle du nombre d’emplois disponibles dans l’économie, n’est jamais posée. Le constat est pourtant assez simple : il n’y a pas assez de postes à pourvoir. Le gouvernement est aujourd’hui en échec. Pourtant, l’objectif initial, inverser la courbe du chômage, n’était pas très ambitieux ! Il devait être atteint en un an. Désormais, c’est pour la fin du quinquennat. Sauf que les derniers chiffres de la DARES donnent 5,4 millions de chômeurs. Le plus inquiétant reste l’explosion du nombre de demandeurs longue durée, qui sont au chômage depuis plus de deux ans. Ils sont actuellement 1,3 million. Le coût humain et économique est considérable.
La politique économique actuelle ne peut pas créer d’emplois, tout simplement parce que l’austérité a de puissants effets récessifs. Ça, c’est pour la demande. En ce qui concerne les politiques de l’offre, on se limite à des recettes libérales. Bon, ils veulent parler d’offre ? Et bien d’accord, parlons des politiques de l’offre ! Il n’y a pas de politique industrielle. La politique européenne de la concurrence s’y est progressivement substituée. Pour arriver à quelque chose, il faudrait commencer par réfléchir à la nature et à la qualité des produits générés par l’économie. Posons-nous la question suivante : qu’est-ce que l’on veut produire, et pour quoi faire ? Une véritable politique industrielle est absolument nécessaire.
 Après les lois Macron et Rebsamen, le rapport Combrexelle menace le Code du travail d’une réforme profonde qui donnerait plus de poids aux accords d’entreprise au détriment de la loi. Philippe Légé décrypte les attaques contre le droit du travail.
Après les lois Macron et Rebsamen, le rapport Combrexelle menace le Code du travail d’une réforme profonde qui donnerait plus de poids aux accords d’entreprise au détriment de la loi. Philippe Légé décrypte les attaques contre le droit du travail. 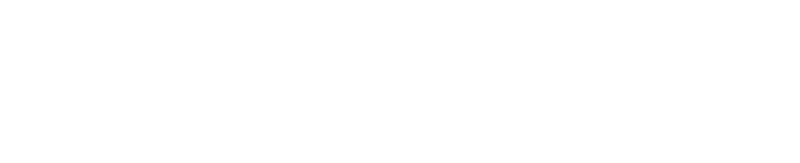
Soyez le premier à poster un commentaire.