 « François Maspero est mort chez lui, samedi 11 avril. Alerté par une fuite d’eau, on l’a découvert dimanche mort dans sa baignoire. Il avait passé la journée du vendredi 10 avec moi, qui l’avait amené dans une clinique de banlieue où il a subi un examen radiologique demandé par le spécialiste qui le suivait. Il avait 83 ans. Hier, on honorait la libération de Buchenwald où est mort son père. Je connaissais François depui près de quarante ans et, au fil des ans, il était devenu mon meilleur ami. Il y a environ quinze jours, il assistait à la maison des syndicats à la projection du film que ses amis lyonnais lui ont consacré. Une nombreuse assistance était là et a pu dialoguer avec lui. Nous n’imaginions pas que ce serait sa dernière apparition. Sa fille Julia était au Québec mais a pu être prévenue par téléphone. Comme tous ceux qui l’ont connu sa disparition me cause une douleur difficile à surmonter. Marcel-Francis Kahn »
« François Maspero est mort chez lui, samedi 11 avril. Alerté par une fuite d’eau, on l’a découvert dimanche mort dans sa baignoire. Il avait passé la journée du vendredi 10 avec moi, qui l’avait amené dans une clinique de banlieue où il a subi un examen radiologique demandé par le spécialiste qui le suivait. Il avait 83 ans. Hier, on honorait la libération de Buchenwald où est mort son père. Je connaissais François depui près de quarante ans et, au fil des ans, il était devenu mon meilleur ami. Il y a environ quinze jours, il assistait à la maison des syndicats à la projection du film que ses amis lyonnais lui ont consacré. Une nombreuse assistance était là et a pu dialoguer avec lui. Nous n’imaginions pas que ce serait sa dernière apparition. Sa fille Julia était au Québec mais a pu être prévenue par téléphone. Comme tous ceux qui l’ont connu sa disparition me cause une douleur difficile à surmonter. Marcel-Francis Kahn »
En hommage à François Maspero, mais aussi pour aider celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de le connaître ni de le rencontrer, nous vous invitons à lire (ou relire) ci-après un long billet rédigé en 2009 sur son blog de Médiapart par Edwy Plenel.
François Maspero, homme livre, homme libre
Mediapart est partenaire de l’exposition François Maspero et les paysages humains qui se tient au Musée de l’imprimerie à Lyon, jusqu’au 15 novembre 2009, et dont Antoine Perraud a déjà rendu compte. Lundi 12 octobre, je participe à un débat avec l’éditeur et écrivain autour de son œuvre-vie d’homme livre et d’homme libre (à 18 h 15, aux Archives municipales de Lyon sises 1, place des Archives). En prologue à cette rencontre, voici le texte que j’ai écrit pour le catalogue de l’exposition et que j’ai intitulé La fidélité Maspero.
En 1959, un jeune libraire du Quartier latin décidait de devenir éditeur. Il commença par lancer une collection qu’il choisit d’intituler « Cahiers libres », en hommage transparent à son ancêtre en rébellions, Charles Péguy, le fondateur des « Cahiers de la quinzaine ». Puis, afin d’éviter toute méprise sur ses intentions éditoriales, il plaça en exergue du catalogue des premiers titres publiés ces mots du même Péguy : « Ces cahiers auront contre eux tous les menteurs et tous les salauds, c’est-à-dire l’immense majorité de tous les partis. »
Pour que lesdits menteurs et salauds ne se trompent pas d’adresse, l’artisan éditeur-libraire préféra signer ouvertement son forfait : ses « Cahiers libres » paraîtraient à l’enseigne de son nom – François Maspero, tout simplement. Nulle quête de notoriété ou de gloriole dans son choix ; plus essentiellement, l’envie d’assumer ses actes dans une époque obscure où la saloperie faisait le plein dans l’abjection de la torture d’Etat, cette gangrène autorisée et encouragée, tandis que les menteurs ne manquaient pas, notamment parmi la gauche officielle, celle qui perdit son honneur en faisant la guerre au peuple algérien et en votant les pleins pouvoirs à Guy Mollet.
D’emblée, le parrainage de Péguy inscrivait cette aventure improbable dans une longue randonnée qui, sans doute, ne s’achèvera qu’avec l’humanité.
En historien militant, ou l’inverse pareillement, Pierre Vidal-Naquet, qui fut par la suite l’un des auteurs de l’éditeur Maspero, a souligné ce dreyfusisme qui traversait les réseaux de soutien à la cause de l’indépendance algérienne : cette intuition commune à des hommes et des femmes d’horizons divers, aussi bien libertaires que trotskystes, chrétiens de gauche que radicalement libéraux, que se jouait dans cette affaire no
n seulement la souveraineté d’un peuple – l’algérien – mais, plus encore, l’âme d’une nation – la nôtre. Et que, comme toujours dans ces batailles éternelles, il s’agirait de gueuler quelques vérités contre les faussaires et les tricheurs. En référence explicite au « J’accuse » d’Emile Zola, l’une des brochures du Comité Maurice Audin qui, à l’été 1958, recensait en Algérie tortures, meurtres collectifs, villages rasés et populations massacrées, s’intitulait Nous accusons. Vérité-Liberté fut le titre du journal créé en 1960 par Vidal-Naquet dans la foulée du Comité Audin, chronique informée des tortures et autres crimes officiels, dont les deux concepts accolés faisaient explicitement écho au ressassement du dreyfusard Péguy : « Dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité en nuyeuse, tristement la vérité triste. »
Suivre la piste Péguy pour retrouver Maspero, c’est traquer encore d’autres résonances. Après tout, Péguy lui-même tenait boutique au Quartier latin, rue de la Sorbonne, à trois pas de la place Paul-Painlevé qui, au numéro 1, sera longtemps le siège des éditions Maspero ; et à quelques minutes de la rue Saint-Séverin où l’éditeur Maspero fut libraire entêté, sous l’enseigne festive de « La joie de lire ». Surtout, du Péguy dreyfusard, on n’a encore rien dit si l’on se contente de rappeler qu’il soutenait l’innocence du capitaine Dreyfus sans préciser qu’alors, il était aussi sympathisant libertaire, influencé par ces anarchistes, révoltés ou révolutionnaires, qui réveillèrent les consciences, bousculèrent les habitudes et insufflèrent les avant-gardes – au premier rang desquels Bernard Lazare dont il sculpta la statue dans Notre jeunesse, en 1910. Les libertaires donc, autrement dit une gauche à la fois radicale et non conformiste, indocile et incontrôlable, inclassable en somme, tout comme le fut – et l’est encore – la gauche d’élection de François Maspero.
Avant qu’il ne se lance dans le défi des Cahiers, les premiers articles de Péguy parurent dans la Revue blanche, refuge de toutes les audaces littéraires, picturales et politiques de la Belle Epoque – la seule à entretenir alors le souvenir de la Commune de Paris par une enquête fouillée auprès de ses acteurs survivants. Or son maître d’œuvre était Félix Fénéon, rescapé du « procès des Trente » de 1894 durant lequel, armé de lois d’exceptions qui, pour la postérité, resteront « les lois scélérates », l’ordre établi avait vainement tenté de faire un sort aux intellectuels de l’anarchie. Un temps journaliste, l’anarchiste Fénéon fut artisan de revue, de style et de mots, critique d’art incomparable, éditeur, traducteur et galeriste, défricheur de goûts et de talents, mais aussi communiste libertaire jusqu’à son dernier souffle.
Fénéon, l’ami de Mallarmé et de tant d’autres, peintres et poètes, l’élégance et la discrétion au service d’une intransigeante fidélité. Fénéon dont le portrait par Félix Vallotton en rédacteur en chef de la Revue blanche, courbé sur ses épreuves dans la position du correcteur, m’évoque la passion de François Maspero pour l’artisanat du livre, sans excepter aucun de ses savoir-faire. A très exactement un siècle de distance, la même passion : en 1998, dans un recueil de poésies traduites par ses soins, publié hors commerce par les librairies « L’arbre à lettres », Maspero en témoignait comme je le fais ici – par le détour d’une admiration. Présentant ce livre d’amour – « Traduire la poésie est une démarche amoureuse. Contre la mort. » –, il commence par rendre hommage à Guy Lévis Mano et à ses éditions GLM ; Mano, ce poète, traducteur, typographe, imprimeur, éditeur, dont il écrit qu’il représente pour lui « un idéal vécu : la fusion d’un artisan et d’un artiste, pour faire, simplement, un homme de métier ».
De Maspero à Péguy, aller et retour, entre passions intellectuelles et passions professionnelles, je pourrais, d’un tournant de siècles à l’autre, filer la résonance à l’infini. Car c’est ainsi : chaque fois que j’écris sur Maspero, je tombe sur Péguy. Son temps, ses postures et ses figures. Ce fut le cas notamment en 1999, dans les premières pages de L’épreuve – livre dédié à François Maspero –, où je les embarque tous deux, complices et contemporains malgré eux, dans un coup de colère et de tristesse contre le retour exacerbé du national dans notre paysage politique, contre ses confusions et ses illusions, ses peurs et ses replis, ses aigreurs et ses rancœurs, ses haines et ses mensonges – ce retour dont l’élection de Nicolas Sarkozy en 2007 à la présidence de la République sera la sanction.
Evidemment, cet apparentement peut surprendre, tant il déjoue les étiquettes commodes et les classements automatiques. S’agissant de Péguy, il troublera ceux qui, pour l’adopter ou le rejeter, ne veulent voir que le patriote exalté de la fin, éclipsant sa jeunesse irréductible à laquelle il se voudra toujours fidèle. Quant à Maspero, cette référence dérangera ceux qui simplifient les authentiques radicalités, soit parce qu’ils les prennent à la légère, les épousant en amateurs éphémères, soit parce qu’ils les observent avec ignorance, les caricaturant parce que leurs adversaires bornés. Car, de l’un à l’autre, l’enseignement est identique : qu’il n’est pas de loyale dissidence sans véritable fidélité ; qu’une conviction sincère n’exclut pas la lucidité critique ; qu’embrasser la jeunesse du monde, c’est aussi sauver de la tradition.
Au-delà des personnalités et des parcours, ce ricochet est donc de pure logique : d’une « Affaire » l’autre, tout simplement. Car l’anticolonialisme fut notre affaire fondamentale qui, à l’instar de l’affaire Dreyfus, sera toujours instruite, jamais classée. Et ce que, pour l’éternité, Péguy nous enseigne de la première affaire, cette mystique d’un engagement fort et entier comme le serait l’évidence même, ne devant rien aux combines et aux tactiques, Maspero nous l’a appris, vie et œuvre mêlés, pour la seconde.
Sans doute chaque génération rencontre-t-elle son épreuve fondatrice. Toutes sont uniques, évidemment. Mais toutes ont partie liée. Les résistants des premières heures sont ceux qui le comprennent d’emblée, entrevoyant ce lien fragile et se précipitant dès lors pour sauver du passé dans le présent quant d’autres se résignent, s’égarent ou se renient en piétinant le présent par amour aveugle du futur et de ses illusoires promesses. Forcément minoritaires, les audacieux de la première cohorte commencent par dire non. Non aux majorités grégaires. Non aux suivismes moutonniers. Non aux pensées automatiques. Non aux slogans uniformes. Non à la foule en somme.
« Nous avons vu la foule, toute soûlée de l’injustice qu’elle avait bue, se ruer contre un homme injustement condamné. Et nous avons connu que la foule n’est pas socialiste. » Le constat est de Péguy dans L’épreuve, un texte posthume de 1898 que j’ai découvert après avoir publié mon essai éponyme. Emile Zola venait d’être condamné pour son « J’accuse », une foule vindicative l’avait pris à partie et des émeutes antisémites avaient ensanglanté les principales villes de l’Algérie, alors française. La conclusion de cet article inédit inscrivait au cœur de l’espérance progressiste le refus des raisons d’Etat en leurs infinies variantes – de Parti, de Classe, de Nation, de Patrie, d’Identité, d’Idéologie, de Religion, etc. : « Nous donnerons au peuple un autre enseignement que l’enseignement de haine ou de lâcheté ; nous ne serons jamais […] les courtisans de la foule, mais nous irons droit au vrai peuple et nous lui enseignerons le socialisme ; en particulier nous lui enseignerons que les socialistes doivent toujours marcher pour l’entier recouvrement de la justice, et non pas essayer de faire leurs affaires à coup d’injustices, comme ces jurés marchands de vin qui reçoivent, nous disent les journaux d’Esterhazy, autour de leurs comptoirs les compliments de leurs clients. »
D’une affaire l’autre, donc. Et, entre-temps, tant d’autres affaires, de l’une à l’autre. A contre-courant, dans tous les cas. Contre l’imposture régnante. Contre le mensonge dominant. Contre l’injustice effective. Contre le conformisme satisfait. Dans les années 1930, des trotskystes et des socialistes anti-staliniens invoquèrent la soif de vérité de Péguy dans leurs brochures qui dénonçaient la farce sinistre des Procès de Moscou. A l’orée des années 1940, des gaullistes firent de même pour refuser l’abaissement de l’armistice, puis l’avilissement de la collaboration. Et, donc, au mitan du siècle, les partisans de l’indépendance algérienne et, plus largement, des tiers-mondes souverains à l’heure de la décolonisation et de la fin des empires – si lente, si violente, si douloureuse et contrainte dans le cas français. Ici, les affinités sont de principes et de réflexes, non pas de croyances ou de calculs. En somme : c’est ainsi, parce qu’il ne saurait en être autrement.
Passeur de refus, dans la fidélité aux disparus, François Maspero l’exprime à propos de ses père et frère résistants dans Les abeilles et la guêpe : « C’est pour dire : des (grands) mots en isme, non je n’en vois guère, dans tout ce qu’ont fait mon père et mon frère. En tout cas, pas dans ce qui les a poussés à le faire. Les ismes, dans cette histoire, on peut toujours les mettre après coup. Mais pas avant. On peut les rencontrer en chemin. Ils ne sont pas là au départ. » Tout combat, la détermination qu’il exige, la concentration qu’il réclame, donne l’apparence d’être claquemuré dans un monde à part, à l’écart et en dehors – c’est la guêpe évoquée par Maspero, réduite à son aiguillon, sans le miel des abeilles qui l’ont précédée. Pour autant, agir par intime conviction ne signifie pas forcément se soumettre à d’inébranlables certitudes. Aussi, dans le même essai autobiographique, évoque-t-il Frantz Fanon, ce psychiatre martiniquais devenu révolutionnaire algérien après avoir été jeune soldat de la France libre, en ces termes : « Il est une phrase de Fanon qui me le rend proche : « Mon ultime prière : ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge. » »
Editeur des Damnés de la terre de Fanon, qui firent le tour du monde, Maspero nous rappelle donc qu’un engagement logique n’exclut pas le doute méthodique. Que choisir n’est pas forcément s’endormir. Que prendre parti n’est pas inévitablement perdre conscience. Fanon était à l’opposé des essentialismes identitaires et des simplismes partisans qu’hélas, les indépendances nouvelles n’éviteront pas, dans une forme de survivance des anciennes oppressions sous la libération conquise. « Le fil de la pensée de Fanon, poursuit Maspero, s’est interrompu, tranché en pleine action. Il appelait à extirper « la peur de l’autre ». Dans sa vision des nouvelles indépendances, l’espoir était partagé avec la lucidité critique, avec ses mises en garde contre « les mésaventures de la conscience nationale » et le danger de trahison des nouvelles bourgeoisies locales. Il n’a pas vu l’instauration des systèmes néo-coloniaux mettre fin à l’espoir. »
Nul hasard si le fil tiré par Fanon, d’Ouest en Est, des plus anciennes colonies françaises – les Antilles – aux plus récentes – la conquête algérienne, symbole de l’expansion africaine –, est aujourd’hui prolongé par son compatriote cadet, qui fut aussi son ami, le poète Edouard Glissant, visionnaire du Tout-monde et des créolisations. Cette généalogie essentielle, dont Maspero est à la fois l’emblème et le gardien, dit ce que l’anticolonialisme portait d’irréductible, au-delà des circonstances momentanées et des causes particulières : le souci du monde et, par conséquent, des autres. Une question qui, loin d’avoir été réglée une fois pour toutes, est plus actuelle que jamais dans notre XXIe siècle, traversé de déséquilibres et de peurs, de dominations déchues et de certitudes ébranlées. Depuis ce pays, la France, ce continent, l’Europe, cette culture, d’Occident, il nous faut désormais apprendre à vivre dans un monde que nous ne dominerons pas, que nous ne soumettrons plus, que nous ne façonnerons plus à notre image. De ce long et douloureux apprentissage, achèvement de cette cavalcade par laquelle l’Occident européen s’est projeté sur le monde, la cause anticoloniale eut très tôt la prescience – et c’est pourquoi elle fait encore désordre.
Dans Les abeilles et la guêpe, c’est quand il évoque Fanon que Maspero met les points sur les i : « On a taxé le livre de Fanon de « bible du tiers-mondisme ». J’ai été et je suis encore souvent, pour ma part, taxé d' »éditeur tiers-mondiste ». J’ai, à une époque où la pensée et la littérature restaient repliées sur les nations de la vieille Europe et de l’Amérique blanche, cherché d’autres pensées et d’autres littératures. Plus d’un tiers de l’humanité, ces années-là, « émergeait » avec les nouvelles indépendances. Il fallait lui donner la parole. Ce n’était pas le cas, alors. Je revendique ma faible part de ce travail-là. Mais je n’ai pas cru à une inversion de la hiérarchie des valeurs. Le tiers-monde, puisque c’est ainsi que l’avaient baptisé des sociologues, devait prendre sa place, jouer son rôle dans l’humanité, rien de plus, mais rien de moins. J’étais dans la ligne du projet énoncé par Sylvain Levi en 1925 dans ces Cahiers du mois auxquels mon père avait participé : rabattre « l’orgueil dément de l’Europe qui prétend faire la loi au monde ». »
L’œuvre entière de François Maspero – cette libre université populaire que fut sa librairie « La joie de lire », cette ouverture à la diversité du monde et aux audaces de pensée dont atteste le catalogue de ses éditions, cette fidélité entêtée, toute de précaution envers les êtres et de respect envers les faits, qu’exprime l’ensemble de ses livres –, oui, tout l’œuvre-vie de Maspero témoigne d’une extrême cohérence dont le point d’ancrage fut, me semble-t-il, la question coloniale – moment déclencheur, thème révélateur. Et cet exemple, le sien, nous importe, pour aujourd’hui, pour demain. Car, de même que le combat contre l’antisémitisme de la fin du XIXe siècle fut annonciateur des combats décisifs du siècle suivant face au fascisme et au nazisme, de même les combats contre le colonialisme durant le XXe siècle auront été porteurs des enjeux décisifs du siècle qui a commencé. De la guerre soviétique en Afghanistan, prélude de la fin de l’URSS, à l’invasion américaine de l’Irak, ébauche du choc des civilisations, en passant par la course à l’abîme d’Israël dans l’oppression de la Palestine, ceux qui refusent de voir la pertinence de cet héritage sont, au choix, aveugles, irresponsables ou criminels.
Telle est pour moi la fidélité Maspero : une présence au monde et aux autres en forme d’alerte inquiète et soucieuse, dans l’espoir d’éviter de nouvelles catastrophes. Et, de cette présence, la question coloniale est l’épreuve cardinale, entendue au sens large comme refus des civilisations prétendues supérieures et des oppressions supposées libératrices. Cette fidélité, un livre en porte témoignage plus que d’autres. Un livre à part, tenu quelque peu à l’écart des bibliographies les plus courantes de François Maspero, et que je voudrais ici remettre au centre et au cœur.
Car les menteurs et salauds de tous les partis ont sans doute crié victoire quand, en 1982, ils ont vu François Maspero renoncer à son métier d’éditeur. Mais ils se sont réjouis trop vite : ils avaient oublié l’auteur. Délivré des livres des autres, Maspero, ce timide ombrageux dont j’imagine qu’il n’était pas mécontent de se cacher derrière des piles de manuscrits, nous a soudain révélé, en 1984, avec Le Sourire du chat, l’écrivain qu’il n’avait jamais cessé d’être en secret. Romans, récits, nouvelles, reportages et enquêtes, sans compter les nombreuses traductions : prolongeant l’œuvre éditoriale qui l’avait précédée, une œuvre littéraire s’est largement imposée, avec la fidélité pour trame secrète et la photographie pour compagne complice. Dans le lot, une biographie historique fait exception : en 1993, plus d’une génération après le début de son aventure éditoriale – le temps, chez d’autres, de plusieurs retournements de veste, de cent reniements et de mille amnésies –, François Maspero s’est rappelé au bon souvenir des salauds en leur offrant leur portrait, L’honneur de Saint-Arnaud.
Ce livre fut victime d’un malentendu. Dans leur infinie aptitude à durer, survivre aux offenses et épouser l’air du temps, les salauds ont mille ruses. Dont celle-ci : démasqués, ils trouveront le portrait avantageux. On le sait, pour escamoter un auteur dérangeant, il suffit de le proclamer fréquentable et bienséant, de l’étouffer de reconnaissance et de l’enterrer sous les honneurs. Déjà, quand, en 1990, François Maspero, avec Les Passagers du Roissy-Express, offrit une archéologie sociale du territoire, de ses partages et de ses déchirures, à rebours de l’empressement charitable pour les banlieues – cet humanitarisme à domicile où s’éclipsent le social et le politique -, on le gratifia de compliments dans la presse respectable de tous bords et d’une mention élogieuse dans un discours présidentiel. Avec son Saint-Arnaud, on fit mieux, ou plutôt pire : ici et là, on le déclara fasciné par son héros, séduit par le personnage, presque complice. Ce n’était pas le verdict de lecteurs pressés, mais plutôt de lecteurs dérangés, gênés et embarrassés. Quitte à dénaturer l’œuvre, il leur fallait taire la nouvelle : par le détour d’une biographie classique, qui plus est sur un personnage lointain et oublié, l’écrivain Maspero proclamait sa fidélité à ses engagements d’éditeur.
Car, de tous les livres écrits par François Maspero, celui-ci est sans doute le plus politique et le plus actuel. Sous l’apparence d’un livre d’histoire, c’est de nous qu’il s’agit ici. De ce pays, la France. De l’idée que nous nous en faisons. De sa présence au monde, hic et nunc, selon que nous revendiquons ou que nous rejetons une part de son passé.
Péguy revendiquait pour ses Cahiers le droit de « faire des personnalités ». Il entendait par là donner « des coups pour de bon, non des coups pour la démonstration ». Parce que, ajoutait-il, « la guerre est la guerre, et, quand on se bat, on tape ». Maspero a donc choisi de se faire une personnalité, ce maréchal Achille Le Roy de Saint-Arnaud qui ne s’appelait ni Achille ni Saint-Arnaud. Saint-Arnaud, à première vue, c’est la conquête de l’Algérie et le coup d’Etat du 2 décembre, les « Arabes » enfumés et la « canaille » mitraillée. Mais c’est bien plus que cela : au travers de ses lettres, publiées après sa mort en 1854 par sa famille, louées par Sainte-Beuve comme l’exemple même de « l’esprit français », devenues l’un des bréviaires des bien pensants du Second Empire, c’est la crapulerie personnifiée, la crapulerie établie et honorée, revendiquée et légitimée. La crapulerie d’Etat. Le crime national.
« Ce général avait les états de service d’un chacal », disait Victor Hugo de cet aventurier officiel, dont les crimes eurent force de loi et dont les vilenies furent montrées en exemple. « Les crimes sont faits grandement ou petitement ; dans le premier cas, on est César, dans le second cas, on est Mandrin. César passe le Rubicon, Mandrin enjambe l’égout. » Aux premières lignes rageuse de son Histoire d’un crime, écrites à Bruxelles dans les premiers mois de l’exil, le même Hugo frayait le chemin emprunté par Maspero : l’autopsie des petitesses, vastes misères et immenses mensonges, nichées au cœur des grandeurs glorieuses et des réputations fameuses qui font nombre de généalogies d’Etat. Suivra logiquement Napoléon le petit, dont Saint-Arnaud est évidemment l’un des principaux protagonistes, croqué dans sa superbe apparence à la page 105 de l’édition illustrée de 1879. Imaginant l’inhumation provisoire, au clair de lune, des victimes du coup d’Etat, la gravure qui précède, page 101, en dévoile l’envers : le crime.
Où est l’honneur dans la raison d’Etat ? Dans la soif de pouvoir ? Dans l’appétit de conquêtes ? Dans la négation des peuples ? Dans l’indifférence aux injustices ? En faisant de Saint-Arnaud le modèle parfait de la veulerie intelligente, du banditisme réussi et de la bassesse promue, ce sont ces questions que Maspero a choisi de nous poser. Mais sa force est de le faire mine de rien, par petites touches, avec une ironie placide et une distance mordante. « Aux amitiés véritables, il faut de belles cassures », disait encore Péguy. Dès lors, nul besoin de rupture grandiloquente quand il s’agit de l’ennemi. Ce n’est pas frayer avec la crapule que la déshabiller de l’intérieur. Ce n’est pas être fasciné que l’approcher au plus près. C’est au contraire lui faire la guerre loyalement, honnêtement, moralement. Péguy toujours, s’expliquant sur la bonne manière de « faire des personnalités » : « la première loyauté consiste à traiter nos adversaires et nos ennemis comme des hommes, à respecter leur personne morale (…), à garder, au plus fort du combat et dans toute l’animosité de la lutte, la propreté, la probité, la justice, la justesse, la loyauté, à rester honnêtes, à ne pas mentir. »
Telle est la force redoutable du travail de Maspero, de son écriture rigoureuse et sensible : en lui donnant vie et humanité, il nous oblige à côtoyer l’imposture ; il nous contraint à fréquenter ce que l’on préférerait simplement détester, et donc ignorer.
Préfaçant en 1995 l’édition de poche de L’honneur de Saint-Arnaud – préface dont j’ai repris ici certains passages –, je me demandais, de façon purement rhétorique, si ce n’était pas faire grand cas d’une histoire ancienne qui nous serait devenue étrangère. Après tout, ajoutais-je, l’époque comme les contrées arpentées par ce salaud emblématique nous sont bien lointaines. La décennie suivante s’est chargée de répondre au-delà du raisonnable puisque c’est en 2005 qu’une partie de la droite française a souhaité inscrire dans la loi le « bilan positif » de la colonisation. Puis, en 2007, l’élection de Nicolas Sarkozy, l’aventurier qu’elle s’est choisie pour sauver son pouvoir, a confirmé outre mesure l’actualité de Saint-Arnaud : bonapartisme exacerbé, oligarchie renouvelée, virulence revendiquée, arrogance et suffisance, mensonges et crapuleries… Or s’il est une constance dans ce nouveau régime, c’est bien la persistance de l’héritage colonial, des populations banlieusardes renvoyées à leur barbarie de « racailles » à l’Afrique du discours de Dakar mise en congé d’histoire, en passant par les peuples d’outre-mer dédaignés et méprisés.
Par le détour de ce voyage en saloperie universelle, François Maspero nous avait donc alerté. En ciblant ce maréchalissime bandit officiel, il nous rappelait qu’il était encore des voix françaises, en notre siècle, pour faire de Napoléon III, celui-là même dont Saint-Arnaud fit sabre au clair un Empereur sur les décombres de la Deuxième République, l’incarnation de « la grandeur de la France ». Voix qui sont, depuis 2007, aux premières loges du pouvoir, de Philippe Séguin à Alain Minc, tous deux biographes empressés et enamourés de Louis Napoléon. Et, dans ce bref moment de répit où l’on avait pu croire l’affaire entendue, Maspero nous réveillait en provoquant tous les inconsolables orphelins de ladite grandeur qui, aujourd’hui, sont de l’incessante fête élyséenne, recevant colifichets et décorations, postes et places, en récompenses de leurs reniements et revirements.
Il faut croire que, de cette débâcle, Maspero avait eu la prémonition. Sans doute parce qu’il s’entraîne à voir, tant la fidélité est une ascèse de la mémoire. Ici, se souvenir, c’est prévenir. Se rappeler, c’est deviner. Et c’est une vigilance de longue haleine. Après tout, Léon Blum attendit une quarantaine d’années pour confier ses Souvenirs sur l’Affaire, parus en 1935, l’année du décès d’Alfred Dreyfus, juste un an avant la victoire du Front populaire. Et Maspero lui-même avait patienté autant quand, en 2004, dans un texte adressé à divers amis, il sortit de sa réserve pour défendre « l’héritage des éditions Maspero » contre leur tardive et mensongère réduction à une caricature sectaire, « structuralo-marxiste », voire « franciscano-maoïste »…
La genèse de L’honneur de Saint-Arnaud est du même ordre : une alerte, légère et familière, à la manière d’un point de côté. Une alarme prémonitoire que seule une sensibilité entraînée et aiguisée pouvait percevoir. Avec sa pudeur coutumière, Maspero a préféré celer l’anecdote. Chaque été, La Quinzaine littéraire consacre son numéro d’août à un dossier. En 1990, les collaborateurs de la revue de Maurice Nadeau, parmi lesquels François Maspero, reçurent ainsi une note préparatoire rédigée par un membre du comité de rédaction en vue d’un numéro ayant pour thème : « Que sont « nos » ex-colonies devenues ? » Intitulée « Ce qui manque à ce numéro », elle s’ouvrait par ces mots : « Un réexamen des doctrines anticolonialistes françaises (Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre, Me Vergès, François Maspero, Régis Debray). » Publiée dans le numéro en question, la réponse de Maspero fut cinglante. Retraçant avec une implacable ironie son itinéraire politique, de militant et d’éditeur, cette Confession d’un anticolonialiste est une réplique à tous ceux qui, aujourd’hui, considèrent avec gêne et ressentiment leurs emballements juvéniles pour les indépendances et les tiers-mondes, les révolutionnaires cubains et les communistes antistaliniens. Bref, en guise de « réexamen », une fidélité revendiquée.
Or, c’est au détour de cet article que revient à Maspero un souvenir d’enfance, dont L’honneur de Saint-Arnaud est le prolongement et par lequel il commence naturellement : « La bibliothèque se trouvait dans une pièce très haute… » Et, sur les rayonnages de cette bibliothèque, celle du grand-père maternel, « à leur place immuable, les deux volumes reliés en noir des Lettres du maréchal de Saint-Arnaud ». Dans La Quinzaine littéraire, Maspero laisse déjà entrevoir ce qui devait lui donner l’envie de cette biographie : l’absence totale de scrupule chez Saint-Arnaud, l’aveu clairvoyant du crime qui court tout au long de ses lettres et qui n’empêchait pas Sainte-Beuve et d’autres d’en faire l’exemple idéal à offrir à la jeunesse française.
« Notre premier soin, écrivait ainsi Maspero en 1990, faisant de l’autodérision moqueuse une arme, fut de mettre en place une grande campagne de falsification historique. J’étais moi-même orfèvre en la matière : n’avais-je pas été chassé ignominieusement du Parti communiste français pour avoir diffusé un faux « Rapport secret » attribué à Krouchtchev ? (…) Donc nous n’hésitâmes pas à inventer de toutes pièces des textes prétendument accablants pour la colonisation, et à les glisser dans toutes les bibliothèques de France. (…) Exemple, parmi des milliers : la dénaturation totale que nous opérâmes des lettres du maréchal de Saint-Arnaud. Pour parvenir à faire de ce représentant typique de la France humaniste une brute sanguinaire conquérant la Kabylie par le fer et par le feu, nous glissâmes dans ses lettres des phrases comme celles-ci… » Et Maspero de donner un bref aperçu des horreurs fanfaronnées par Saint-Arnaud, revendiquées avec complaisance et sans état d’âme, horreurs que, par la suite, son livre détaillera à foison. Juste un avant-goût en somme de villages brûlés, de populations massacrées, de cadavres entassés, de têtes coupées, d’enfants piétinés, etc.
« Cet homme est de chez nous. Cet homme est à nous », écrit Maspero dans le prologue de L’honneur de Saint-Arnaud. Le commentant et le prolongeant dans ma préface de 1995, j’ajoutais : « C’est en ce sens que le compte à régler est actuel, tout comme l’est – ô combien – le débat sur la Collaboration. Demain se construit dans ce perpétuel « à présent » du passé que revendiquait Walter Benjamin, à la veille de son suicide de 1940, sur la frontière close des Pyrénées, en citant Karl Kraus : « L’origine est à la fin. » La France d’aujourd’hui, celle d’une fin de règne délétère, de ruines et d’impostures, celle de la diabolisation de l’islam et des nostalgies de puissance, celle des grandes peurs méditerranéennes, est aux prises avec ses amnésies collectives, ses trous de mémoire que furent Vichy et l’Algérie, auxquels on pourrait ajouter l’oubli de la ferveur de Mai 1968, cette grande frayeur des puissants. »
Ces réflexions ont beau avoir près de quinze ans, leur refrain nous semble encore familier. 1995, c’était la fin de l’interminable présidence de François Mitterrand dont le legs de déception et d’impuissance, de survie et d’amnésie, de renoncements et d’embarras, pèse encore sur la gauche française. Legs dont, à l’inverse, la présidence de Nicolas Sarkozy a tiré profit, brandissant comme autant de prises de guerre ces transfuges qui, passés de la gauche à la droite, ne croient pas trahir tout simplement parce qu’ils étaient déjà égarés.
Lire et relire Maspero, c’est aussi comprendre ce qui nous est arrivé. Ce que nous avons perdu en route. Ce à quoi nous n’avons pas prêté suffisamment attention.
« Notre science, c’est le détour et l’aller-venir » : cette phrase d’Edouard Glissant, dans Tout-monde, pourrait caractériser François Maspero. Les vraies fidélités ne sont pas de lignes droites, tracées d’avance, prévisibles et attendues. Elles s’improvisent et s’inventent dans l’échappée, la trace et la sente, ces lignes de fuite qui échappent aux esprits de système, au Grand Un et au Grand Même. Nul hasard, dès lors, si, à Paris, en juin 2006, Maspero reçut le Prix Edouard Glissant pour toute son œuvre.
Nous étions à un an de la fatale présidentielle qui verra l’avènement, dans la France du XXIe siècle, d’un ministère de l’identité nationale. Quelques mois plus tôt, en compagnie de son disciple et complice Patrick Chamoiseau, Edouard Glissant avait publié une adresse à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’intérieur. Son titre : De loin. De loin, autrement dit au plus près, à la façon des photographes Robert Capa et Gerda Taro tels que les a fait revivre Maspero – « savoir capter ce qui se passe autour ». Lors de la remise du prix, j’ai lu un extrait de leur texte, passage qui fait lien et sens, de Saint-Arnaud à Sarkozy, d’avant-hier à demain. Le voici : « Il n’est pas concevable qu’une Nation se renferme aujourd’hui dans des étroitesses identitaires telles que cette Nation soit amenée à ignorer ce qui fait la communauté actuelle du monde : la volonté sereine de partager les vérités de tout passé commun et la détermination à partager aussi les responsabilités à venir. La grandeur d’une Nation ne tient pas à sa puissance, économique ou militaire (qui ne peut être qu’un des garants de sa liberté), mais à sa capacité d’estimer la marche du monde, de se porter aux points où les idées de générosité et de solidarité sont menacées ou faiblissent, de ménager toujours, à court et à long terme, un avenir vraiment commun à tous les peuples, puissants ou non. »
Ces lignes sont une autre façon de dire la fidélité Maspero : sauver le monde en nous pour sauver l’humanité en l’homme. Qu’elle aient été écrites depuis la Martinique, « vieille terre d’esclavage, de colonisation et de néo-colonisation », comme le rappelaient les auteurs, ne doit rien au hasard. Car, ajoutaient Glissant et Chamoiseau, « cette interminable douleur est un maître précieux : elle nous a enseigné l’échange et le partage. Les situations déshumanisantes ont ceci de précieux qu’elles préservent, au cœur des dominés, la palpitation d’où monte toujours une exigence de dignité. »
Depuis, nos deux écrivains n’ont cessé de récidiver, aérant le désert politique du sarkozysme apparemment triomphant par l’envoi des manifestes politiques les plus novateurs qui soient – contre le mur de l’identité nationale (2007), en forme d’adresse à Barack Obama (2008) et pour les produits de haute nécessité (2009). D’un mal, un bien : porter la plume dans la plaie, c’est aussi chercher la médecine. Et si, hier miroir de nos défaites, notre héritage colonial devenait, demain, le laboratoire de nos réveils ?
De quelle France sommes-nous ? C’est la question que posait Maspero dans son portrait d’un salaud. Et c’est au fond la question qu’il n’a cessé de se poser, de nous poser. Oui, quelle France ? Celle de Saint-Arnaud ou celle de Péguy ? Celle de Péguy évidemment, répond Maspero qui, lui-même, et sa modestie dût-elle en souffrir, en est l’incarnation vivante. Et j’ajoute donc, logiquement, car menteurs et salauds règnent encore : celle de Sarkozy ou celle de Maspero ?
La France de Péguy donc, ce libertaire et dreyfusard, ruminant et ressassant, qui n’a cessé de nous alerter depuis ce constat, dressé en 1910 dans Notre jeunesse : « Une seule injustice, un seul crime, une seule illégalité, surtout si elle est officiellement enregistrée, confirmée, une seule injure à l’humanité, une seule injure à la justice et au droit surtout si elle est universellement, légalement, nationalement, commodément acceptée, un seul crime rompt et suffit à rompre tout le pacte social, tout le contrat social, une seule forfaiture, un seul déshonneur suffit à perdre l’honneur, à déshonorer tout un peuple. »
Et la France de Maspero, plus encore. Ce n’est pas là compliment abstrait, mais témoignage direct. François Maspero fut, pour ma génération, l’un de ces hommes rares qui nous réconcilia avec la France. Ayant grandi outre-mer, aux Antilles françaises – et qui le sont toujours –, puis dans l’Algérie fraîchement indépendante, c’est par le détour des livres publiés à son enseigne et de visites vacancières à sa librairie « La joie de lire » que j’ai finalement rejoint ce pays – je veux dire par là cette promesse républicaine où l’esprit national ne se réalise que dans la fraternité universelle, ce qu’en d’autres temps, on nommait l’internationalisme.
A l’époque, d’autres, qui parfois s’en vantent encore, s’amusaient à voler les livres « chez Masp ». Epousant des causes provisoires et des engagements éphémères, ils jetaient ainsi leur gourme dans le frisson de rapines honteuses, pour mieux ensuite vieillir en bourgeois repus, une fois leur jeunesse passée. La jeunesse de Maspero, elle, n’est jamais passée : elle lui est restée, comme une marque de fabrique indélébile. Comme son honneur.
« Trop de survivants sont plus morts que les morts », note-t-il dans Les abeilles et la guêpe. Alors que lui-même incarnera toujours cette jeunesse à vif de l’enfant qu’il n’a jamais cessé d’être, contemporain de ses morts chéris, jeunes pour l’éternité. Ces morts dont les sacrifices lui ont appris ce secret de vie : « Ce n’est pas tout d’être conscient que, toujours, nous guette la banalisation du mal. Il faut se rappeler que le mal a toujours commencé dans la banalité. »
Entre inquiétude et espérance, distance et engagement, cette fidélité vigilante introduit aux liberté scrupuleuses. En ouverture de son premier roman, Le Sourire du chat, où se lisent les blessures qui l’ont façonné, François Maspero glissait déjà cette confidence, longtemps retenue : « J’ai peiné à retrouver le sens du mot liberté. »
Pour ma part, je n’oublierais jamais que ce mot, son risque joyeux comme son exigence douloureuse, il me l’a appris.
Publié dans Pour l’alternative et l’autogestion – 44, le 13 avril 2015
Un autre hommage :
La disparition de François Maspero constitue une perte gigantesque en cette période d’abandon de la culture du livre et plus encore de l’engagement des éditeurs dans la défense de la création en résonance avec la cité. Comme Pier Pasolini pouvait parler de « poètes civils » on doit entendre F. Maspéro comme un de ces rares « éditeurs civils » capables de risquer l’aventure des vents contraires, des histoires « mineures », de ce devenir humain à la hauteur de l’idée de beauté et de résistance que l’on s’en fait chaque fois qu’un combat se mène contre l’injustice et la maltraitance d’une autre part de l’humanité.
F. Maspéro s’inscrit dans la mémoire vive du partage des sources de la connaissance et son courage si malmené ce jour.
Philippe Tancelin (poète-philosophe)
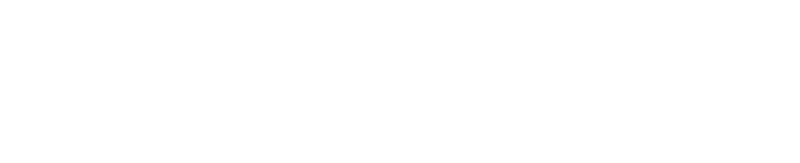
Soyez le premier à poster un commentaire.