Cela pose cette question : que signifie « être conscient de » ?
On voit bien que cette question est trop abstraite. S’il n’existe aucune expérience qui se signale à vous par un ressenti, il n’y aura pas de « conscience ». Le sentir conditionne la conscience « de ». Et il faut bien admettre qu’un état pathologique puisse se développer sans engendrer aucun ressenti, apte à être formulé dans la conscience. Ce sont, en quelque sorte, des développements silencieux. Nombre de maladies, comme le cancer, opèrent ainsi. Nous n’en avons pas conscience. Ce sont des examens médicaux, interprétés par un médecin, qui vont nous l’apprendre.
Il faut, me semble-t-il, admettre ces deux réalités à la fois. La réalité de la connaissance intime et privilégiée de notre état de santé. Et la réalité des développements silencieux, que seuls des examens médicaux permettront de connaitre.
Néanmoins, qu’en est-il de la santé, qui, j’ai insisté sur ce point, n’est pas une absence de maladie ? Car la capacité, non seulement à faire un diagnostic juste, mais à affronter la maladie, dépend bien d’un « ressort » qui existe au sein de chaque individualité, de ce que Spinoza appelle : la puissance de penser et d’agir, associée au désir de persévérer dans son être, donc de vivre.
Aujourd’hui il existe un débat difficile au sein du corps médical sur, non pas les symptômes de maladies graves, mais leur cause. S’agit-il d’une cause externe ou d’une cause interne ? Je remarque que les médecins, dont les plus grands spécialistes, peuvent soigner, tout en ignorant les causes réelles. C’est clairement le cas pour les maladies neurologiques. Par exemple : qu’est-ce qui provoque la maladie de Parkinson ? Autant dire qu’on n’est sait rien !
La tendance majoritaire actuellement pour accéder aux causes est de regarder du côté des gènes. Je n’ai pas les connaissances nécessaires pour contester cette tendance. Il est parfaitement possible qu’elle détienne une part de vérité. Dans ce cas, ce sont les causes internes au corps qu’on privilégie. Mais j’ai l’intuition que de telles maladies peuvent naître d’un environnement social et naturel dégradé, qui provoque une pression permanente sur le cerveau et/ou des chocs émotionnels graves. En tous cas, c’est une explication qui me semble plausible. Pourquoi la recherche médicale n’explore que très peu ce type de piste ?
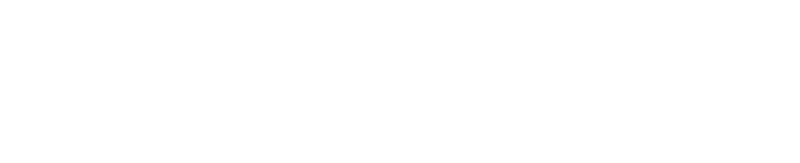

Soyez le premier à poster un commentaire.