Dette publique : Quelle réponse ? Analyse de Christophe Ramaux, membre du conseil scientifique d’Attac-France.
Dette publique : Quelle réponse ?
 Nous publions ici une analyse de Christophe Ramaux, économiste et membre du conseil scientifique d’Attac-France.
Nous publions ici une analyse de Christophe Ramaux, économiste et membre du conseil scientifique d’Attac-France.
article publié le 23/01/2010
Christophe Ramaux, économiste membre du Conseil scientifique d’Attac-France, donne ici, en 11 courts points, son analyse relative au concept de dette publique.
Il souligne, en conclusion, la nécessité d’une autre politique monétaire, d’un retour à une fiscalité progressive et d’une relance budgétaire, ciblée sur certains besoins : l’éducation, la santé, et l’écologie.
Comment appréhender la dette publique ?
Un essai de réponse en onze points.
Il faut la relativiser.
1/ La dette publique française n’a rien d’exceptionnelle.
A 77,1% du PIB fin 2009, elle est dans la moyenne de la zone euro (77,7%), et inférieure à celle des Etats-Unis (84%) ou du Japon (200 % prévu pour 2010).
2/ Les libéraux clament qu’elle représente 22 000 euros par personne. Ils omettent qu’elle a pour contrepartie des titres d’emprunt (obligations) détenues par certains. On ne lègue pas une dette aux « générations futures » : les enfants de salariés risquent en revanche, ce qui est effectivement problématique (cf. ci-dessous), de devoir payer aux enfants de rentiers.
3/ La dette évoquée ici (dite dette « brute ») ne prend pas en compte les actifs publics (routes, écoles, etc.). Avec eux, le solde (ce qu’on appelle la « valeur nette ») est largement positif : près de 600 milliards d’euros en 2008 (30 % du PIB), soit un legs (sans parler du « non monétaire » : connaissance, espérance de vie, etc.), de 9 000 euros par personne (et 20 000 euros par personne si on ajoute le patrimoine « privé »).
4/ On parle toujours du « trou du public », mais pas de celui du privé.
La dette privée des ménages et des entreprises (sans parler des institutions financières), qui vient d’exploser, est pourtant plus conséquente : 120% en France, en 2008, ce qui d’ailleurs assez faible comparé à d’autres pays (175% aux Etats-Unis, environ 200% en Espagne et au Royaume-Uni).
Il faut ensuite saisir la dynamique de la dette.
5/ La dette publique était de 25 % du PIB en 1982. Elle a plus que triplé depuis. Les libéraux pointent l’excès des dépenses comme si l’austérité budgétaire n’avait pas prévalu. Le « solde budgétaire » dépend en fait principalement des recettes. L’optique keynésienne est ici précieuse : en cas de décroissance, on a du chômage, mais aussi une dégradation des comptes publics, à la fois parce que des dépenses augmentent (prestations chômage, etc.), mais surtout parce que les recettes fiscales chutent. Le déficit public est passé de 3,4% en 2008 à 8,2% du PIB en 2009. Cela ne s’explique pas par la « relance » Sarkozy, l’une des plus piteuse au monde, mais par la chute des rentrées fiscales [2]. La dette publique a bondi de 20 points de PIB avec la récession du début des années 1990 (de 36 % en 1991 à 58% en 1996). Elle va bondir à nouveau d’au moins autant. Entre 1997 et 2001, avec la croissance et les créations d’emplois, elle avait baissé de 2,4 points de PIB.
6/ La focalisation sur la dette du public et non du privé renvoie au discours libéral selon lequel le public est improductif et « pèse » sur le privé. Si on considère qu’il crée de la richesse monétaire (ce qui est le cas), il est clair que le déficit public n’est pas en soi un mal : il peut soutenir et lancer des activités.
7/ Il importe finalement de distinguer deux types de déficits. Les déficits expansionnistes : les dépenses publiques soutiennent de façon cumulative la croissance [3]., ce qui permet un surcroît de recettes (c’est l’« effet cagnotte » : l’Etat « gagne ce qu’il dépense » [4].).
Les déficits récessifs : les politiques libérales (dont l’austérité budgétaire), plombent l’activité ce qui creuse les déficits par défaut de recettes.
Restent trois points.
8/ La dette publique s’est aussi creusée en raison des cadeaux fiscaux aux riches, lesquels ont fait d’une pierre deux coups : ils payent moins d’impôts, ce qui oblige l’Etat à emprunter auprès d’eux.
9/ Les politiques monétaires sont aussi responsables : taux d’intérêt réels élevés en particulier dans la zone euro (au début des années 1990 surtout et peut être demain), interdiction (inscrite dans les traités européens) de « monétiser » la dette publique [5]t s’oblige à emprunter sur les marchés à obligation, contre taux d’intérêt. , etc.
 10/ Au final, la dette publique, à l’instar de celle du privé, a été un levier de la financiarisation.
10/ Au final, la dette publique, à l’instar de celle du privé, a été un levier de la financiarisation.
C’est le grand retour des rentiers.
La solution coule de source.
11/ Il faut rompre avec les politiques libérales à tous les niveaux, ce qui passe notamment par une autre politique monétaire, le retour à une fiscalité progressive (la décroissance des hauts revenus donc) et par une relance budgétaire, ciblée pour certains besoins : l’éducation, la santé, mais aussi l’écologie, qui exige d’abord cela (croissance des transports collectifs, du fret ferroviaire, des énergies renouvelables, rénovation thermique des bâtiments…), bien plus que le leurre-arnaque de la taxe carbone.
Pour aller plus loin :
Vive la dette de Marc Bousseyrol (ed. Thierry Magnier, collection Troisième culture, 2009). Notes
[1] Par convention, la dette de la Cades (qui « porte » une bonne part de la dette de la Sécurité sociale) est en fait comptabilisée parmi celle des Odac (Organismes divers d’administration centrale) et non dans celle de la Sécurité sociale. – pesant chacune 10%
[2] Les recettes fiscales ont baissé de 53 milliards entre 2008 et 2009.
[3] Selon le principe dit du « multiplicateur » : un surcroît de dépenses publiques se traduit par un surcroît plus important de la production globale.
Exemple : la construction d’écoles génère des revenus – le salaire des ouvriers qui les construise notamment – qui eux-mêmes vont être dépensés, ce qui va accroître la demande, et donc la production, et donc les revenus, etc
[4] Selon une célèbre formule qui résume la pensée de M. Kalecki (un économiste marxo-keynésien) : « les salariés dépensent ce qu’ils gagnent, alors que les capitalistes gagnent ce qu’ils dépensent ». Un salarié, au cours de sa vie, ne peut guère consommer plus que ce qu’il gagne. Alors que le capitaliste emprunte de l’argent (la dette est donc motrice, inaugurale), qu’il investit avec l’espoir que cela lui permettra non seulement de rembourser la dette initiale mais d’en tirer un profit (il « gagne donc ce qu’il dépense »). Si on considère que l’Etat est productif (ce qu’il est), la formule peut lui être étendue
[5] La « monétisation de la dette » a lieu lorsque la Banque centrale finance directement le déficit public en créant ex nihilo de la monnaie afin d’« acheter » des titres d’emprunts d’Etat (tout comme une banque crée ex nihilo de la monnaie lorsqu’elle accorde un crédit à une entreprise ou un particulier). Ces derniers mois, les Banques centrales américaines et anglaises n’ont pas hésité à recourir à cette pratique (qualifiée de « non conventionnelle »). Ce n’est pas le cas pour la Banque centrale européenne. Les traités lui interdisent (cf. l’art. 104 du Traité de Maastricht repris dans l’art. 123 du traité de Lisbonne), une interdiction que l’on trouve historiquement en Allemagne, mais que la France a reprise en 1973 (loi n°73-7 du 3 janvier 1973, art. 25).
Christophe Ramaux (Economiste, Maître de conférences à l’Université Paris I)
Article paru (en version courte) dans Politis, 29 octobre 2009 En France, la dette publique, est de l’ordre de 1 500 milliards d’euros, avec 80 % pour l’Etat, les collectivités locales et la Sécurité sociale – en comptant la Cades [1].
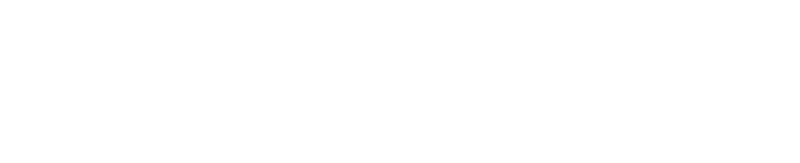

Soyez le premier à poster un commentaire.