Publié le
lundi, 3 août 2015 dans
Point de vueVoici ci-dessous, un texte que j’ai écrit en 2005 et qui me semble rester d’actualité.
Philippe ZARIFIAN
Échelle du monde, crise de civilisation, peuple et luttes.
1. Crise de civilisation ?

Peinture de KALIE
Nous avons l’impression – mais nous sommes loin de pouvoir entièrement le rationaliser – que nous vivons une crise d’une profondeur considérable. Nous risquons bien davantage de la sous-estimer que de la surestimer. Quelque chose meurt, dans la trajectoire de la civilisation occidentale, elle-même devenue beaucoup trop influente pour ne pas entraîner dans son sillage les autres espaces civilisationnels.
Meurt d’abord, mais selon d’incessants soubresauts, à la manière d’un dragon blessé, tout le systémisme économique, toute l’énorme machinerie fonctionnelle que le capitalisme, comme rapport social, a engendré. Ce que Deleuze qualifiait d’axiomatique, régulant des flux sans codes et sans territoires, est aussi un vaste mécanisme fonctionnalisant la vie humaine, lui assignant place, rôle, résultats, finalités, et rejetant tout ce qui n’est pas fonctionnellement utile dans une période donnée.
Marx a visé juste en parlant des capitalistes comme des « fonctionnaires » du capital, ou encore en les désignant comme « porteurs » du capital. Le systémisme n’aura pas été un choix théorique, mais une analyse lucide de la « mise en système » d’un fonctionnement qui ne répond à aucune volonté spécifique, qui s’auto-entretient avec une formidable efficacité, un vaste automate auquel jamais personne, dans les phases antérieures de notre civilisation, n’aurait pu penser.
Certes, il aura fallu que certaines passions correspondantes se développent et prennent de l’ampleur socialement : le culte protestant du travail, l’appât du gain, voire la morale utilitariste.
Mais elles n’ont jamais été centrales.
C’est lorsque la machine se dérègle, que le dragon commence à défaillir, que les passions latérales s’exacerbent. Un capitalisme de plus en plus corrompu, ou, selon une direction complémentaire, un capitalisme qui exacerbe et radicalise ses référents moraux protestants, est un capitalisme malade, qui, au sens rigoureux du terme, dysfonctionne. Et personne n’a le pouvoir de le réparer. Cette bête blessée devient méchante. Elle détruit, modifiant ainsi son orientation première. Vaste machine à innover, parce que l’innovation était le moteur de son ressourcement, apte à surmonter ses crises périodiques de valorisation économique, voici que le système s’égare : assis sur des bases rétrécies, il se polarise sur les simples flux de capital-argent, en exacerbant et radicalisant la pression mise sur ce qui peut encore les alimenter, sous l’épée de Damoclès de provoquer des soubresauts périodiques, qui s’expriment dans les crises financières.
Le moindre salarié, le moindre individu fonctionnellement assujetti à son rôle dans une entreprise, sent monter une pression et une insécurité qui deviennent à la limite du supportable. Il devient l’alter-ego des pauvres et des exclus, de ceux que le système n’absorbe plus.
Et voici que se pose à nous cette énorme question : devons-nous rester sans rien faire ? Autrement dit : pouvons-nous vivre sans l’économique ? Si l’axiomatique centrale se meurt, si toutes les régulations connexes se délitent, si les institutions correspondantes entrent en crise, pouvons-nous simplement contempler la fuite des flux ainsi « libérés », qui risquent bien plutôt de se comporter comme des brisures de radeaux sur une mer déchaînée, des flux plus contraints dans leur errance qu’ils n’ont jamais été ?
Voici une question énorme dont, involontairement, nous héritons : comment « défonctionnaliser » notre civilisation ? Comment laisser le monstre automate s’agiter dans ses convulsions, sans être entraîné par la dépendance qu’il a su créer, car de lui, de son fonctionnement, nous tirons, nous, hommes hautement civilisés, notre subsistance élémentaire? Défonctionnaliser les conduites de base dans notre civilisation. Ou plutôt édifier de nouvelles formes de production de notre existence qui ne soient plus l’expression esclave d’une vaste machinerie qui engendre et répartit les biens, autant qu’elle engendre et répartit les classes sociales et les conflits. Se meurt aussi la démocratie libérale.
La vaste fiction sur laquelle notre civilisation moderne s’est constituée, fiction d’un individu « libre », détenteur de droits-pouvoirs, inhérents à sa condition d’homme-citoyen, qui délègue le soin à des partis et des représentants de gouverner en son nom, se délite. Elle se délite comme croyance. Elle se délite aussi parce que la violence intrinsèque de l’Etat réapparaît dans une exacerbation du volontarisme politique, sorte d’équivalent du dérèglement du fonctionnalisme économique. Nous voyons apparaître ou réapparaître l’arbitraire de la prise de décision des hauts dirigeants, et du petit groupe de « conseillers » qui les entourent, pouvoir arbitraire dont le formalisme juridique et la promulgation des lois ne sont plus que l’enveloppe. La démocratie libérale est devenue trop coûteuse, coûteuse en adhésion passive de la part des supposés citoyens, coûteuse en respect des institutions et des sanctions juridico-politiques de la part des gouvernants. La mécanique électorale reste le dernier rempart d’une vie politique qui se vide à la fois de sa légitimité et de sa légalité.
La crise de l’Etat-Social et des protections qu’il accorde n’y est pas pour rien. L’adresse directe, par l’intermédiaire des médias, des hauts gouvernants aux « individus de base » devient la méthode centrale de gouvernement. Elle se repositionne très largement sur le registre des passions tristes, de la peur, de la culpabilité. Ce délitement est progressif.
Il n’a pas besoin de passer par l’instauration d’un état d’exception ou d’une dictature. Mais il sape les croyances démocratiques. Plus les gouvernants agitent le drapeau de la démocratie et du « monde libre » (face aux barbares orientaux), plus nous pouvons constater, nous habitants de ce monde, que la démocratie se vide et les libertés se réduisent. Il ne s’agit aucunement, dans les pays centraux, d’un retour du populisme. L’adresse directe qui se fait à travers les médias n’est pas celle d’un souverain en direction de « son » peuple. Le peuple n’existe plus. Face à des individus supposés atomisés, les gouvernants prêchent de plus en plus dans le vide : vide de l’intérêt qui est porté à leurs propos, vide de l’espèce d’indifférence et de résignation à la fois qui est manifestée à leur égard par les supposés « citoyens ». Mais l’important est que cette prêche devient, d’une certaine manière, sans importance. La souveraineté s’exprimera dans des décisions, se présentant comme « décisionnistes », volontaristes, sans avoir réellement à se réclamer de la légitimité populaire, ni d’un débat d’opinion. Sarkozy en est, en France, la caricature.
La politique est absorbée par le politique, la souveraineté politique par l’urgence de l’action étatique. Car, voici bien le ressort de cette liquidation partielle de la démocratie libérale : il y a urgence à faire face, comme pouvoir d’Etat, à des menaces d’effondrements économiques et financiers, comme il y a urgence à apparaître au centre du nouveau régime de guerre. Ce qui se faisait encore tranquillement, dans la période dite néo-libérale, se radicalise brusquement. L’Etat réaffirme son pouvoir, au moment même où la politique se délite.
Non pas Etat d’exception, car les règles démocratiques peuvent continuer d’être respectées, mais Etat sans vie politique réelle, même fictionnelle. L’exercice d’un pouvoir, qui s’affirme de plus en plus dans sa violence intrinsèque, sans être soutenu par une croyance dans la fiction libérale, ni modéré par cette dernière. Car il ne s’agit plus, ni de gouverner la population, ni de discipliner les corps. Il s’agit de trancher dans le vif, sur le soutien financier aux firmes globalisées, sur le sécuritaire, sur le régime de guerre, sur un Etat-Social devenu trop coûteux, etc.
Lorsque des manifestations de rue dénoncent cette évolution, elles le font de manière sympathique, mais avec l’emprunt d’une période passée, une vieille fiction « mouvementiste », et une efficacité concrète limitée.
Nous voici confronté à ce nouveau défi : comment penser la politique d’une civilisation émergente ? Est-ce que l’appauvrissement de la politique doit nous inciter à chercher à la revivifier, ou ne faut-il pas plutôt se dire que le débat public devient, et doit devenir de plus en plus, un espace d’intermédiation vers la prise en charge ouverte d’enjeux éthiques, portant sur le vivre libre, à la fois singulièrement personnel et mondialisé ? Est-ce que le fameux adage maoïste, « la politique au poste de commande », n’est pas en train de rendre l’âme? La question n’est plus : qui gouverne ? , mais : comment assurer la plénitude du vivre et nous engager dans sa promotion ? Comment repenser la démocratie sur des bases éthiques, post-politiques ? Meurt enfin la configuration idéelle (idéologique) qui a supporté la preuve de la modernité de la civilisation occidentale.
Malgré les fractures que quelques géants hétérodoxes de la pensée, Hobbes, Spinoza, Marx, Nietzsche, ont su opérer, le corpus dominant s’est réduit à une sorte de vaste tautologie : la civilisation occidentale est civilisée, et apte à engendrer le progrès. La civilisation occidentale est LA civilisation. Son univers est en permanence, dans et malgré ses conflits, propice à la pacification, à la rationalisation, à l’intellectualisation, au triomphe de la raison et au progrès matériel. Elle est un univers du droit, apte à domestiquer les puissances sauvages. C’est moins la philosophie que la sociologie qui a fourni les idéologèmes de base autour desquels, dans d’infinies et monotones variations, cette configuration idéelle a pu se développer. La civilisation occidentale moderne s’organise autour de deux pôles qui cherchent en permanence à s’équilibrer : l’individu et la société. Entre les deux : les institutions intermédiaires. L’individuel, le social et le collectif. L’individuel pour l’idéal de liberté, le social pour la cohésion et l’intégration globales, le collectif pour les conflits qui animent le progrès. L’équilibre dynamique est fourni par les institutions régulatrices et l’énergie normative et contestable du droit. En permanence se créent des déséquilibres, en permanence ils sont surmontés.
Cet univers refoule désirs et sauvagerie, il annihile l’expression des puissances. Il ne peut connaître que son négatif : la barbarie. Pleine raison ou barbarie, ordre et progrès ou régression. Nous pouvons pencher vers l’individualisme ou nous laisser porter par le holisme ou encore nous laisser bercer par l’infinie variation des relations humanistes aux autruis, les autres que nous-mêmes, c’est toujours la même histoire qui se raconte. Et tous ensemble, nous, individus du premier monde, des pays centraux, nous pouvons nous réjouir d’être civilisés. Quelle gloire !
Parfois les ravages de la guerre et de la barbarie que l’occident « civilisé » promeut peuvent animer des doutes sur la réalité de notre civilisation, mais aucune réalité n’a jamais été assez forte pour ruiner une configuration idéelle, une idéologie. Or voici qu’elle entre en crise, non seulement par délitement interne, mais parce que d’autres idées se font jour.
Ces idées nous disent que ni les individus, ni la société n’existent, comme idées adéquates, et que les idéologies collectives n’ont jamais été que de pâles et mortelles références. Elles nous disent que seules existent des individualités, des puissances, des compositions, des coopérations, des devenirs, des événements. Elles nous disent que l’opposition entre civilisation et barbarie est un leurre, que la civilisation occidentale moderne a toujours secrété, dans sa modernité même, la barbarie. Elles nous invitent à lier désormais, dans la positivité assumée de leur tension, sauvagerie et puissance de la pensée. Elles nous font voir des propensions et des croisements de perspectives sur le monde, là l’on voulait nous faire croire à une pseudo-liberté négative. Elles en appellent au déploiement de la générosité, là où l’on voulait, idéellement, nous enfermer dans la cohabitation d’intérêts égocentrés.
Un autre univers s’offre à notre regard et à notre langage. Moins qu’une reconfiguration idéelle de notre civilisation, on peut penser – et la gravité de la question écologique nous y invite – qu’il s’agit d’un décentrement vers l’édification d’une nouvelle cosmologie, d’une nouvelle vision du cosmos, dont la civilisation humaine n’est qu’une partie. Et nous ne partons pas de rien : les émergences d’idées nouvelles au cœur de la modernité renouent à la fois avec les formidables élaborations des grands penseurs hétérodoxes – ceux du 16 et 17ème siècles en particulier -, mais aussi avec des traditions civilisationnelles enfouies ou largement détruites, qui avait su porter leur ambition au niveau d’une cosmologie. L’un des exemples les plus étonnants en reste la cosmologie des amérindiens .
2. La mort artificiellement provoquée des civilisations.
La pensée écologique nous a appris à développer une réflexion et une action sur la disparition précipitée et artificiellement provoquée des espèces vivantes. Une formule la résume : la réduction de la bio-diversité. Il faut prendre cette réflexion avec rigueur pour éviter de tomber dans la naturalisme ou dans toute approche nostalgique. Que des espères disparaissent, cela n’a rien de nouveau et de préoccupant en soi. Cela fait partie des grands cycles des mutations et des événements » catastrophiques » peuvent induire des disparitions brutales. Mais il faut porter attention aux deux adjectifs : » précipitée » et » artificiellement provoquée « .
Car, là où nous avons toutes bonnes raisons de nous préoccuper de la réduction de la bio-diversité (au sens large du terme), c’est qu’à la fois :
– elle engage notre responsabilité spécifiquement humaine face à l’existence des générations futures, renvoyant au Principe Responsabilité mis en lumière par Hans Jonas,
– elle affaiblit le potentiel du vivant, dont celui de notre propre espèce.
Bien des exemples peuvent en attester : des plantes à pouvoir médicinal qui disparaissent, c’est une source de soin et de guérison qui s’évanouit. Des espères animales qui disparaissent, ce sont des chaînes du vivant qui sont rompues, entraînant, soit des proliférations incontrôlées d’autres espèces, soit des suites inévitables de mort d’autres espèces. Des espèces animales et végétales qui disparaissent, ce sont souvent des paysages entiers qui se modifient progressivement, avec, par exemple, le développement de nouvelles zones désertiques. Ou bien encore, c’est la régénération de l’eau et l’oxygénation des océans qui se dégradent. Sur un tout autre registre, des espèces » belles » ou » touchantes « , qui font partie de notre patrimoine historique, qui disparaissent, ce sont des sources d’émotion et d’esthétisme qui se tarissent. C’est la grisaille et l’uniformité qui s’étendent Enfin, et de manière plus profonde encore, on peut se demander si la capacité de l’espèce humaine à détruire en masse des formes vivantes différentes d’elle n’affaiblit pas son propre corps, en raréfiant les sources d’affections (par la nourriture, par le climat, par les contacts avec d’autres espèces et micro-organismes, etc.) qui portent le corps humain à développer sa puissance. C’est comme si se mettaient en place des processus de dégénérescence, masqués par les progrès de la médecine. On sait, et ce n’est plus à démontrer, que la mort précipitée d’espèces vivantes (des bactéries, des insectes…) provoquent, chez les espèces restantes, des mutations et endurcissements qui les rendent beaucoup plus résistantes à l’action humaine.
Un cycle infernal s’enclenche ainsi.
Il faut certes prendre les métaphores avec précaution. Mais nous sommes proche de penser que l’on peut utiliser cette comparaison pour penser ce qui se produit actuellement : la mort, pour ne pas dire la tuerie des civilisations « étrangères » à l’occident. Pour ne pas dire « étrangère à la version américanisée du mode de vie et de pensée occidental ». Nous disons « américanisée », nullement pour mettre spécifiquement en cause les Etats-Unis, mais, à la manière de Gramsci, pour typifier un mode de vie et de pensée dont les Etats-Unis sont le centre de diffusion et promotion, version qui, à sa façon, est devenue un vecteur essentiel de développement et pénétration des intérêts économiques (car l’effet va bien au-delà des luttes pour la captation des ressources pétrolières : la mondialisation non critique du mode de vie occidental est » le » vecteur de pénétration de la globalisation économique, celui que les grandes firmes utilisent).
Ce n’est pas la première fois que des civilisations auront été massacrées. Que reste-t-il, par exemple, des civilisations indiennes des deux Amériques ? Pratiquement rien, sinon une indicible souffrance et misère. Et que deviennent les magnifiques civilisations africaines ? Après avoir été étouffées, niées, » christianisées « , décomposées par la colonisation, ce qui se passe en ce moment est pire : elles périssent et se décomposent par la mort physique, les maladies, la plus que misère et les guerres intestines de ce continent. Par son abandon. Mais un nouveau front a été désormais ouvert en » Orient » (mot inventé par les..occidentaux en voulant tracer une barrière entre civilisations). L’Orient résistait à l’américanisation (baptisée, pour la cause, « modèle de démocratie et liberté « , celui que nous éprouvons bien, nous occidentaux, dans ses limites).
La résistance de l’Orient doit être brisée : voici la nouvelle croisade. Une sorte de haine de l’Orient commence à être encouragée, une étrange paranoïa. Les puissances occidentales se dénomment elles-mêmes…occidentales : ce n’est pas un qualificatif innocent. C’est l’Occident face au reste du monde. Quelques tribus supposées sauvages en Afghanistan ? Qu’à cela ne tienne : l’armée onusienne, les organisations humanitaires, les différentes sources d’aide et l’arrivée de la culture occidentale, en viendront à bout, sous le bouclier militaire, soigneusement installé, par les Etats-Unis. De guerre en guerre, la croisade occidentale pénètre de plus en plus en profondeur et s’arroge de plus en plus de droits d’intervention directe (au mépris du droit international, mais que vaut-il, lorsque liberté est donnée à la force pure de s’exercer, avec la bénédiction de Dieu et l’étendard du Bien ?). Nous assistons, sur nos écrans de télé, à la disparition rapide et sciemment provoquée de toutes les civilisations non blanches, non occidentales, non judéo-chrétiennes. Bref : de tout ce que les Bush, de toutes espèces (car ces espèces là prolifèrent), détestent.
Bien entendu, nous pouvons, raisonnablement, mettre en avant les apports considérables de la civilisation occidentale, en particulier sur le registre de la liberté individuelle, de la démocratie, de l’émancipation des femmes, et de la croissance du bien être matériel. Nous pouvons, tout aussi raisonnablement, mettre en lumière les destructions et impasses considérables que cette civilisation a opérées. Mais, en tout état de cause, nous pouvons et devons développer le souci de ce que chaque civilisation peut apporter d’inédit et d’éthiquement positif à l’humanité-monde.
Par exemple, la civilisation indienne de la zone du Brésil avait développé un regard d’une grande subtilité et richesse sur les êtres de la nature environnante, animaux et plantes, au sein d’une vision du monde particulièrement passionnante. Mais qu’en reste-t-il? Quelques écrits d’éthnologues et anthropologues. Dès les années 50, Levy Strauss avait lancé un vibrant appel contre la disparition de ces civilisations et l’uniformisation « triste » du monde supposé « civilisé ». Mais qu’en est-il resté? Face aux actuelles croisades, nous, résistants du désert, habitants de Dune, nous apprenons, nous nous endurcissons à notre manière.
Nous sommes riches de la richesse du croisement des civilisations. Mais le risque existe de ressembler à nos tueurs, de sombrer dans les passions tristes du ressentiment et de la revanche. Nous devons lutter par des armes généreuses, et d’autant plus fermes, tenaces, indestructibles. Chameaux marchants dans le désert : ce magnifique tableau de Klee, nous le faisons notre. Ce pourrait être l’étendard du Peuple Monde, celui de la vraie mondialité. Chaque peuple a droit à ses rêves, peut revendiquer les apports positifs de sa civilisation et de sa manière de vivre, se sentir contributeur de la vaste histoire humaine. La civilisation occidentale n’est ni plus vertueuse, ni plus riche que les autres. Elle est simplement différente, étrange à sa manière, comme l’écrivait Montesquieu par la voix d’Usbeck dans ses lettres persanes.
Elle traverse, comme toute histoire de longue durée, des hauts et des bas. Nous l’avons indiqué, nous avons l’impression confuse que nous tombons, que l’occident a perdu une large partie de sa capacité de création, de beauté et d’élaboration éthique, qu’elle est devenue grise et épuisée, comme étouffée sous l’énormité du déploiement de la violence, de la chasse aux différences, sous la chape de plomb de l’économique et du financier. La vie chez nous, ici, en Occident précisément, devient survie, violence permanente, pression, pornographie. Pensons par exemple à l’étalage, totalement indécent et manipulatoire, sur les antennes des télévisions, des sentiments et de la vie intime des » gens « . Pensons à l’étalage quotidien des cadavres aux actualités. Le sentimentalisme, les pleurs, la peur, le dégoût, les chocs émotionnels remplacent l’appel à l’intelligence.
Il faut des types humains particulièrement tenaces et joyeux pour y résister. Face à une société dure, comment former une jeunesse qui soit résistante, sans céder elle-même à la dureté? Grisaille, horreurs, films catastrophes qui, soudain, se brisent dans la réalité elle-même. Je me souviens. Je me souviens de la Perse, de la Chine, du Vieux Lao Tseu, des accents de Russie, des chats sauvages du Brésil, de mes amis là-bas, de tous les métis du Monde. J’ai parfois honte de ma partie occidentale. Mais je me promène alors dans Paris, doucement, et me rassure. Paris Poète, ce beau livre qui vient de paraître. L’occident a des beaux côtés. Croire que la puissance réside dans la guerre et la violence, quelle bêtise! La guerre n’est que faiblesse, tristesse et lâcheté.
Le faux visage de l’occident a un nom qui n’a pas perdu de ride : la prétention impériale, colonisatrice, celle qui nous étouffe, celle contre laquelle une intellectuelle iranienne se révoltait, criant qu’elle n’avait pas besoin de l’occident pour penser et créer, pour lutter et aspirer à la liberté. Interpellant un journaliste interloqué à qui elle affirmait: « je suis persane! ». Persane, et non pas iranienne. Pourquoi nierait-on, à des parties entières de l’humanité, d’avoir une histoire ? Et pourquoi nous contesterait-on, à nous autres, métis du monde, de faire se rencontrer ces histoires civilisationnelles ?
3. Multitude.
Multitudes, multitude, peuple, classes sociales ? Le débat sur ce point peut sembler abstrait, mais il a des fortes implications quant à la manière de penser les luttes actuelles. Partons de » multitudes » (au pluriel). Et prenons l’exemple de la revue du même nom. Quand on lit le débat qui a présidé à la dénomination de cette revue et au choix de ce pluriel, on est frappé par la question des images et des évocations. Il s’agit de choisir un titre pour une revue. Quelles images appellent multitude au singulier et pourquoi l’avoir rejeté? Images bibliques, image du Dieu créateur, image d’un peuple (de moutons), image de pouvoir, beaucoup plus que de puissance, image de la totalité hégélienne. Ceux qui ont lancé cette revue décident, à juste titre, de rejeter ces images. Ils choisissent multitudes au pluriel. Dans multitudes, se font jour les images de puissances irreprésentables, de diversités, de différences, d’initiatives plurielles irréductibles à l’exercice d’un quelconque pouvoir central. Images et évocations certes, mais, curieusement, aucun concept. Et on voit le malentendu qui peut s’installer.
Car multitude, au singulier, est un vrai concept philosophique, pour chacun des deux grands théoriciens qui l’ont mis en avant, au 17ème siècle. Et concepts qui restent d’actualité. Pour Hobbes d’abord : quel est le problème que Hobbes veut penser? Une société qui ne peut plus prétendre être pré-ordonnée par un quelconque ordre divin ou un quelconque Dieu créateur, une société moderne qui s’émancipe de l’oppression de toutes les formes de théocratie, qu’elle passe par l’Eglise ou par la Royauté. Une société composée, non de sujets d’un ordre transcendant, mais d’humains, dotés de mémoire et de langage, qui se ressemblent, sont égaux en force (l’égalité, son existence irréfutable et expérimentée comme telle, tel est clairement le point de départ de Hobbes), se savent semblables, mais qui sont en même temps poussés par leur propre désir, animés par leur propre capacité à penser et agir, de manière strictement individualisée, différenciée, potentiellement opposée (car les désirs s’opposent dans leur réalisation). Qu’est ce que la multitude comme concept ? C’est ce qui permet tout à la fois de penser le vide que l’écroulement de l’ordre théologico-politique et théocratique (dans sa légitimité et sa vision du monde), crée soudain et le nouvel ensemble constitués par ces individualités en guerre potentielle, trop égales, trop semblables, trop différenciées, trop opposées, surgissant dans ce vide, sans aucun ordre préalable, rien précisément de transcendant ni d’unifié.
Une révolution anglaise sanglante que Hobbes observe et fuit à la fois, mais par rapport à laquelle il comprend, il est un des rares à comprendre alors, qu’il n’existe plus de retour possible en arrière. La multitude au singulier, c’est pour Hobbes un vrai concept dans un système de pensée très rigoureux, qui avance, logiquement, vers le principe d’autorisation ( » nous autorisons le souverain à gouverner à notre place « ), vers la création artificielle du souverain, vers l’édification de la grande machine étatique moderne. Chez Hobbes, la multitude, au singulier, c’est l’inverse du bénitier ou du curé. Ce n’est même pas encore le peuple (comme futur alter-ego du souverain). C’est le pré-peuple. Entre la multitude et le peuple, apparaissent les citoyens au moment même où fictivement (ou bien par le jeu d’élections démocratiques), ils quittent volontairement l’état de multitude pour autoriser un souverain (un Etat absolu) à gouverner. Hobbes, on l’oublie trop souvent, est un grand théoricien du citoyen, comme passage, transition de la multitude au peuple. Car une fois le souverain constitué, la multitude devient son » peuple « , son sujet, mais à partir d’une légitimité moderne et sans que les individus puissent être jamais totalement soumis. Le souverain constitué, institué, n’a plus légalement en face de lui qu’un peuple de sujets (assujetis). Mais, selon Hobbes, la multitude pré-existante ne saurait disparaître : rien ni personne ne peut empêcher que les hommes manifestent le désir de persévérer dans leur être et agissent en conséquence, en visant à s’approprier les objets de leur désir. Dès lors, comme image, la multitude (au singulier), devient le risque de chaos, le désordre toujours potentiel, comme à l’aguet. La grande actualité de Hobbes : le refus radical de fonder une souveraineté politique sur le religieux ou sur tout ordre social préalable. Et le problème soulevé par la solution qu’il propose : l’asservissement du peuple au nouveau pouvoir d’Etat, qui, pour lui, ne peut gouverner que sur la base d’un pouvoir absolu.
Chez Spinoza, c’est autre chose. Multitude, au singulier, est aussi un concept, un concept de composition de puissances, de source de tout pouvoir politique en tant qu’il suppose toujours des puissances en action, un concept qui autorise en même temps de penser la résistance au pouvoir lui-même, pouvoir d’Etat qui exprime les puissances (les pouvoirs de pensée et d’action des individus) et s’en sépare à la fois. Un pouvoir politique , un » pouvoir sur « , qui peut à tout moment tenter de couper les puissances d’elles-mêmes, affaiblir les individus, les priver de leurs potentialités. Que faut-il entendre par » puissance » ? C’est, pour Spinoza, le » pouvoir de « , le pouvoir de pensée et d’action, que tout individu possède, qui met en jeu à la fois la puissance de son intelligence et celle de son corps, puissance qui peut se renforcer, par les affects de joie, par l’accès à la connaissance de soi et du monde, ou s’affaiblir, par les affects de tristesse et de haine, par le recul de la connaissance, le recours aux différentes formes de superstition. Dans le concept spinoziste de multitude, le politique comme « pouvoir sur » les individus et la politique comme « pouvoir de », puissance des individus s’affrontent, mais sur fond d’une ontologie de la puissance qui reste première.
La multitude est assemblage, rencontre, composition, coopération des puissances individuelles, mais dans un régime de servitude vis à vis tout à la fois : des passions qui animent les individus (joie et tristesse, amour et haine), et vis-à-vis du pouvoir d’Etat qui agit sur la multitude pour procurer sécurité et paix, mais aussi, et par là même, sous ce prétexte, oppression et privation de la possibilité de développer sa puissance, privation de la vraie liberté.
Chez Spinoza, le principal champ de bataille n’est pas celui des dominés contre les dominants, mais fondamentalement celui des individus face à eux-mêmes. La politique ne se joue pas dans le politique. Le choix du politique, du meilleur gouvernement possible, doit se faire en considération de ce qu’il autorise pour que les individus se libèrent de leurs passions tristes, de leurs haines et affaiblissements, de leurs superstitions et accèdent pleinement à l’exercice positif de leur puissance de connaissance et d’action. Elle se joue en définitive dans l’émergence difficile d’hommes libres (des hommes libres au pluriel, car il n’y a de liberté possible que dans la coopération). Et les hommes ne deviennent réellement libres que dans une éthique, dans une manière de vivre, de manière post-politique.
Chez Spinoza, la politique n’est pas « au poste de commande ». Elle n’est elle-même qu’une transition. L’actualité formidable de Spinoza : voir que l’essentiel se joue, non au sommet d’un Etat, mais dans les facultés de connaissance, de coopération, de générosité, d’autonomie que les individus parviennent à développer.
Le » bon gouvernement » est celui qui permet, du plus possible, ce déploiement. Et qui, d’une certaine manière, œuvre à son auto-limitation et son dépassement. Plus les hommes sont libres, moins ils ont besoin d’Etat. La multitude récupère alors sa force propre.
Nous proposerions volontiers un troisième concept, que nous préférons qualifier de » peuple-monde « , plutôt que multitude pour éviter toute réduction, soit sur Hobbes, soit sur Spinoza. Quel est le problème ? Chez Spinoza, la référence à des puissances garde un caractère assez mystérieux, que l’on ne peut comprendre qu’à partir de son ontologie globale. Qu’est-ce qui fonde ces puissances ? De quoi sont-elles l’expression ? Il faut alors penser la Substance, la Nature, un Dieu immanent. Or, on peut tenter une autre voix : partir des rapports (rapports sociaux, rapports humains-nature), des tensions qui se font jour dans ces rapports, des individualités qui s’y forment et en surgissent. Partir de Marx en quelque sorte, mais en réintégrant tout l’apport de Spinoza (et toute la rupture d’avec un ordre préalable que Hobbes a si remarquablement opérée).
On peut voir un peuple-monde comme une composition d’individualités humaines, issues des rapports sociaux où elles se forment et se développent, dans des initiatives et des luttes multiples, car au sein de tensions permanentes. Nous proposons de voir un peuple-monde comme une composition de foyers, de centres irradiants dans leurs actes, chacun totalement unique et singulier, mais formant un ensemble, un peuple et un monde intersubjectif, comme une lumière composée de mille faisceaux. C’est à partir et à travers ces foyers que les puissances prennent source et s’expriment.
On découvre alors que les résistances, dans les luttes, sur divers fronts, précédent toute oppression. C’est contre elles que les oppressions se font jour et que le pouvoir d’Etat ne cesse de se réorganiser. Luttes qui n’arrivent que difficilement à se nommer, car elles ne sont pas fondamentalement « contre » un pouvoir ou une police. Elles sont d’abord à la recherche de leurs propres foyers (la lutte des enseignants du printemps 2003 en France, la lutte des intermittents, les luttes qui secouent périodiquement notre monde, sans objectif assignable, sans téléologie, mais avec force).
Trouver les foyers, les identifier, en comprendre et saisir ce qui en surgit, affermir leur composition, la capacité des individualités humaines ainsi engagées à former un peuple libre. Un exemple : le mouvement des enseignants du printemps 2003 a surgi, sans que personne ne comprenne bien ce qui se passait (les motifs que les enseignants se sont donnés étaient confus et ne disaient rien d’essentiel). Il a surgi comme événement. Même chose pour le mouvement des lycéens de mars 2005. Quelque chose est passé du virtuel à l’actuel, dans le monde social. Et a commencé à s’en dégager un sens : celui de mondes possibles, d’autres manières de prendre l’enseignement et l’étude. La manière d’enseigner et d’étudier, de leur redonner sens sur fond de crise de l’institution scolaire, est venue au centre des débats, des craintes, mais aussi des espoirs. Mais si les mondes possibles sont la manière dont on peut commencer à donner sens à un conflit, il ne faut pas s’y limiter. On risque vite de basculer dans l’irréel, ou dans le pur langagier, dans le discours ou dans le pur intersubjectif (le débat d’individus à individus), dans des relations pauvres, déjà épuisées parce que sans fondement, sans base.
Et c’est bien ce qu’on constate souvent dans un conflit : sa richesse première, son actualité, sa force, sa face d’actualisation, s’épuisent dans des énoncés, des débats militants, des discours d’observateurs, qui progressivement se vident de sens, au lieu de le former, de l’impulser. Dans l’événement d’une lutte qui, au départ, nous saisit, nous prend, il faut trouver le réel qui s’actualise, c’est-à-dire, dans ce cas, une autre manière de vivre la question de l’enseignement. Il faut comprendre le réel qui nous pousse et avec lui les rapports sociaux dans lesquels nous nous exprimons. Et c’est en tant que ce réel nous pousse que nous pouvons en produire des possibles, en former du sens. Dans une lutte, l’important n’est pas dans l’objectif affirmé, qui ne peut être que réducteur et souvent défensif, mais dans les actes actuels à partir desquels des possibles se forment, des utopies jaillissent, des manière d’agir ensemble apparaissent. Et c’est quand on perd le sens de cette actualité, que la lutte commence à dériver.
Et on ne lutte pas principalement contre (contre un gouvernement, contre des dominants, des puissants, etc.). On lutte principalement pour exprimer des puissances et des possibles, dans les événements du monde et face à leurs enjeux. C’est ce qui fait que, dans chaque lutte, chaque engagement, nous pensons et agissons dans un plan « autre » de réalité que les dominants ( le ministre de l’éducation, voulant imposer sa réforme), dans des rapports sociaux, des subjectivations, des désirs, des manières de faire et de penser qui s’actualisent au présent du conflit ou du débat. C’est ce qui fait que nous nous engageons dans une lutte. Et ces « manières » parlent déjà d’elles-mêmes, sans avoir besoin de se figer sur l’obsession des dominants et des puissants. En passant du virtuel au possible, du poussé au désiré, en imaginant des mondes possibles et en débattant, on exprime alors, individuellement et collectivement (dans des collectifs qui se forment dans l’actualité du conflit), le mouvement même du réel, ce que Marx appelait… le communisme.
Mais à l’inverse, c’est lorsqu’on commence à oublier le mouvement du réel, quand on commence à oublier de s’en saisir pour imaginer des possibles, quand on cesse d’associer le « poussé » et le « tiré », l’actuel et le futur, lorsque la rhétorique » militante » s’installe et que l’on ne pense plus qu’en termes d’objectifs, que l’on commence à perdre.
L’affrontement aux « puissants » est, en réalité, le plus facile : il faut surtout développer une bonne compréhension des corrélations de forces et de la stratégie. Si on ne peut gagner un jour, on pourra gagner dans une conjoncture plus favorable. Mais c’est surtout de l’intérieur qu’un conflit s’affaiblit, s’épuise ou dérape. Perdre pied, c’est à la fois oublier le réel de l’événement et se perdre dans des débats et des querelles sans fin, oublier de former un peuple et de » peupler » cette composition d’individualités des ressorts qui s’actualisent en elle. Ce qu’il faut penser, c’est l’événement du conflit lui-même, toujours dans son actualité, tendu entre le passé et le futur, en anticipation, mais sans « programme ». Parler de l’événement, agir en fonction de son déploiement, comprendre ce qu’il actualise. C’est à partir de là que l’on peut construire, émettre, partager des désirs de possibles, devenir collectivement fort. Constituer un peuple-monde donc et tracer des perspectives communes d’émancipation…
Peuple-monde de l’événement, Peuple Monde de la mondialité, par ricochet dans l’eau, des luttes internes vers leur écho sur la scène de cette mondialité. La manière dont les madrilènes, les espagnols, ont contre-effectué l’attentat du 11 mars 2004 est de ce point de vue remarquable. Non seulement ils ont su faire face avec justesse et force à l’événement dramatique qui les atteignait, mais leur affirmation du désir de paix, leur action pour le retrait des troupes espagnoles en Irak, a eu aussitôt une répercussion et des effets sur la scène mondiale. La politique de Bush, Blair, Sharon, Berlusconi, Aznar a été frontalement et durablement atteinte. Un pas a été fait vers la paix, par une prise en charge du terrorisme toute différente de celle qui, depuis Israël et les Etats-Unis, ne cessaient et ne cessent de l’engendrer.
(extrait légèrement modifié de Philippe Zarifian, L’échelle du monde, chapitre V, éditions La Dispute, octobre 2004)
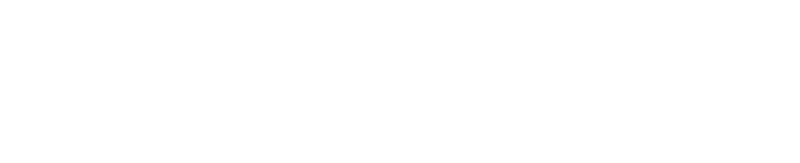

Soyez le premier à poster un commentaire.